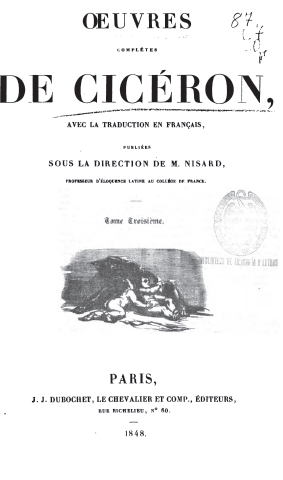|
I. Diuturni silentii, patres conscripti, quo eram
his temporibus usus - non timore aliquo, sed partim dolore, partim uerecundia -
finem hodiernus dies attulit, idemque initium quae uellem quaeque sentirem meo
pristino more dicendi. Tantam enim mansuetudinem, tam inusitatam inauditamque
clementiam, tantum in summa potestate rerum omnium modum, tam denique
incredibilem sapientiam ac paene diuinam, tacitus praeterire nullo modo possum.
M. enim Marcello uobis, patres conscripti, reique
publicae reddito, non illius solum, sed etiam meam uocem et auctoritatem et
uobis et rei publicae conseruatam ac restitutam puto. Dolebam enim, patres
conscripti, et uehementer angebar, uirum talem, cum in eadem causa in qua ego
fuisset, non in eadem esse fortuna; nec mihi persuadere poteram, nec fas esse
ducebam, uersari me in nostro uetere curriculo, illo aemulo atque imitatore
studiorum ac laborum meorum, quasi quodam socio a me et comite distracto. Ergo
et mihi meae pristinae uitae consuetudinem, C. Caesar, interclusam aperuisti, et
his omnibus ad bene de (omni) re publica sperandum quasi signum aliquod
sustulisti.
Intellectum est enim mihi quidem in multis, et
maxime in me ipso, sed paulo ante (in) omnibus, cum M. Marcellum senatui reique
publicae concessisti, commemoratis praesertim offensionibus, te auctoritatem
huius ordinis dignitatemque rei publicae tuis uel doloribus uel suspicionibus
anteferre. Ille quidem fructum omnis ante actae uitae hodierno die maximum
cepit, cum summo consensu senatus, tum iudicio tuo grauissimo et maximo. Ex quo
profecto intellegis quanta in dato beneficio sit laus, cum in accepto sit tanta
gloria. (4) Est uero fortunatus ille, cuius ex salute non minor paene ad omnis
quam ad ipsum uentura sit laetitia peruenerit. Quod quidem ei merito atque
optimo iure contigit. Quis enim est illo aut nobilitate aut probitate aut
optimarum artium studio aut innocentia aut ullo laudis genere praestantior?
II Nullius tantum flumen est ingeni, nullius
dicendi aut scribendi tanta uis, tanta copia, quae non dicam exornare, sed
enarrare, C. Caesar, res tuas gestas possit. Tamen adfirmo, et hoc pace dicam
tua, nullam in his esse laudem ampliorem quam eam quam hodierno die consecutus
es. Soleo saepe ante oculos ponere, idque libenter crebris usurpare sermonibus,
omnis nostrorum imperatorum, omnis exterarum gentium potentissimorumque
populorum, omnis clarissimorum regum res gestas, cum tuis nec contentionum
magnitudine nec numero proeliorum nec uarietate regionum nec celeritate
conficiendi nec dissimilitudine bellorum posse conferri; nec uero
disiunctissimas terras citius passibus cuiusquam potuisse peragrari, quam tuis
non dicam cursibus, sed uictoriis lustratae sunt.
Quae quidem ego nisi ita magna esse fatear, ut ea
uix cuiusquam mens aut cogitatio capere possit, amens sim: sed tamen sunt alia
maiora. Nam bellicas laudes solent quidam extenuare uerbis, easque detrahere
ducibus, communicare cum multis, ne propriae sint imperatorum. Et certe in armis
militum uirtus, locorum opportunitas, auxilia sociorum, classes, commeatus
multum iuuant: maximam uero partem quasi suo iure Fortuna sibi uindicat, et
quicquid prospere gestum est, id paene omne ducit suum.
At uero huius gloriae, C. Caesar, quam es paulo
ante adeptus, socium habes neminem: totum hoc quantumcumque est (quod certe
maximum est) totum est, inquam, tuum. Nihil sibi ex ista laude centurio, nihil
praefectus, nihil cohors, nihil turma decerpit: quin etiam illa ipsa rerum
humanarum domina, Fortuna, in istius societatem gloriae se non offert: tibi
cedit; tuam esse totam et propriam fatetur. Numquam enim temeritas cum sapientia
commiscetur, neque ad consilium casus admittitur.
III. Domuisti gentis immanitate barbaras,
multitudine innumerabilis, locis infinitas, omni copiarum genere abundantis: sed
tamen ea uicisti, quae et naturam et condicionem ut uinci possent habebant.
Nulla est enim tanta uis, quae non ferro et uiribus debilitari frangique possit.
Animum uincere, iracundiam cohibere, uictoriam temperare, aduersarium
nobilitate, ingenio, uirtute praestantem non modo extollere iacentem, sed etiam
amplificare eius pristinam dignitatem, haec qui fecit, non ego eum cum summis
uiris comparo, sed simillimum deo iudico.
Itaque, C. Caesar, bellicae tuae laudes
celebrabuntur illae quidem non solum nostris, sed paene omnium gentium litteris
atque linguis, nec ulla umquam aetas de tuis laudibus conticescet. Sed tamen
eius modi res nescio quo modo etiam cum leguntur, obstrepi clamore militum
uidentur et tubarum sono. At uero cum aliquid clementer, mansuete, iuste,
moderate, sapienter factum - in iracundia praesertim, quae est inimica consilio,
et in uictoria, quae natura insolens et superba est - audimus aut legimus, quo
studio incendimur, non modo in gestis rebus, sed etiam in fictis, ut eos saepe,
quos numquam uidimus, diligamus!
Te uero, quem praesentem intuemur, cuius mentem
sensusque et os cernimus, ut, quicquid belli fortuna reliquum rei publicae
fecerit, id esse saluum uelis, quibus laudibus efferemus? quibus studiis
prosequemur? qua beneuolentia complectemur? Parietes (me dius fidius) ut mihi
uidetur huius curiae tibi gratias agere gestiunt, quod breui tempore futura sit
illa auctoritas in his maiorum suorum et suis sedibus.
IV. Equidem cum C. Marcelli, uiri optimi et
commemorabili pietate praediti, lacrimas modo uobiscum uiderem, omnium
Marcellorum meum pectus memoria obfudit, quibus tu etiam mortuis, M. Marcello
conseruato, dignitatem suam reddidisti, nobilissimamque familiam iam ad paucos
redactam paene ab interitu uindicasti. Hunc tu igitur diem tuis maximis et
innumerabilibus gratulationibus iure antepones. Haec enim res unius est propria
C. Caesaris: ceterae duce te gestae magnae illae quidem, sed tamen multo
magnoque comitatu. Huius autem rei tu idem es et dux et comes: quae quidem tanta
est, ut tropaeis et monumentis tuis adlatura finem sit aetas, - nihil est enim
opere et manu factum, quod non (aliquando) conficiat et consumat uentustas: at
haec (tua iustitia et lenitas animi) florescet cotidie magis, ita ut quantum
tuis operibus diuturnitas detrahet, tantum adferat laudibus.
Et ceteros quidem omnis uictores bellorum ciuilium
iam ante aequitate et misericordia uiceras: hodierno uero die te ipsum uicisti.
Vereor ut hoc, quod dicam, perinde intellegi possit auditum atque ipse cogitans
sentio: ipsam uictoriam uicisse uideris, cum ea quae illa erat adepta uictis
remisisti. Nam cum ipsius uictoriae condicione omnes uicti occidissemus,
clementiae tuae iudicio conseruati sumus. Recte igitur unus inuictus es, a quo
etiam ipsius uictoriae condicio uisque deuicta est.
V. Atque hoc C. Caesaris iudicium, patres
conscripti, quam late pateat attendite. Omnes enim, qui ad illa arma fato sumus
nescio quo rei publicae misero funestoque compulsi, etsi aliqua culpa tenemur
erroris humani, scelere certe liberati sumus. Nam cum M. Marcellum deprecantibus
uobis rei publicae conseruauit, me et mihi et item rei publicae, nullo
deprecante, reliquos amplissimos uiros et sibi ipsos et patriae reddidit: quorum
et frequentiam et dignitatem hoc ipso in consessu uidetis. Non ille hostis
induxit in curiam, sed iudicauit a plerisque ignoratione potius et falso atque
inani metu quam cupiditate aut crudelitate bellum esse susceptum.
Quo quidem in bello semper de pace audiendum
putaui, semperque dolui non modo pacem, sed etiam orationem ciuium pacem
flagitantium repudiari. Neque enim ego illa nec ulla umquam secutus sum arma
ciuilia; semperque mea consilia pacis et togae socia, non belli atque armorum
fuerunt. Hominem sum secutus priuato consilio, non publico; tantumque apud me
grati animi fidelis memoria ualuit, ut nulla non modo cupiditate, sed ne spe
quidem, prudens et sciens tamquam ad interitum ruerem uoluntarium. Quod quidem
meum consilium minime obscurum fuit. Nam et in hoc ordine integra re multa de
pace dixi, et in ipso bello eadem etiam cum capitis mei periculo sensi. Ex quo
nemo iam erit tam iniustus existimator rerum, qui dubitet quae Caesaris de bello
uoluntas fuerit, cum pacis auctores conseruandos statim censuerit, ceteris
fuerit iratior. Atque id minus mirum fortasse tum, cum esset incertus exitus et
anceps fortuna belli: qui uero uictor pacis auctores diligit, is profecto
declarat se maluisse non dimicare quam uincere.
VI. Atque huius quidem rei M. Marcello sum testis.
Nostri enim sensus ut in pace semper, sic tum etiam in bello congruebant.
Quotiens ego eum et quanto cum dolore uidi, cum insolentiam certorum hominum tum
etiam ipsius uictoriae ferocitatem extimescentem! Quo gratior tua liberalitas,
C. Caesar, nobis, qui illa uidimus, debet esse. Non enim iam causae sunt inter
se, sed uictoriae comparandae. Vidimus tuam uictoriam proeliorum exitu
terminatam: gladium uagina uacuum in urbe non uidimus.
Quos amisimus ciuis, eos Martis uis perculit, non ira uictoriae; ut dubitare
debeat nemo quin multos, si fieri posset, C. Caesar ab inferis excitaret,
quoniam ex eadem acie conseruat quos potest. Alterius uero partis nihil amplius
dicam quam (id quod omnes uerebamur) nimis iracundam futuram fuisse uictoriam.
Quidam enim non modo armatis, sed interdum etiam otiosis minabantur; nec quid
quisque sensisset, sed ubi fuisset cogitandum esse dicebant: ut mihi quidem
uideantur di immortales, etiam si poenas a populo Romano ob aliquod delictum
expetiuerunt, qui ciuile bellum tantum et tam luctuosum excitauerunt, uel
placati iam uel satiati aliquando, omnem spem salutis ad clementiam uictoris et
sapientiam contulisse.
Qua re gaude tuo isto tam excellenti bono,
et fruere cum fortuna et gloria, tum etiam natura et moribus tuis: ex quo quidem
maximus est fructus iucunditasque sapienti. Cetera cum tua recordabere, etsi
persaepe uirtuti, tamen plerumque felicitati tuae gratulabere: de nobis, quos in
re publica tecum simul esse uoluisti, quotiens cogitabis, totiens de maximis
tuis beneficiis, totiens de incredibili liberalitate, totiens de singulari
sapientia tua cogitabis: quae non modo summa bona, sed nimirum audebo uel sola
dicere. Tantus est enim splendor in laude uera, tanta in magnitudine animi et
consili dignitas, ut haec a uirtute donata, cetera a fortuna commodata esse
uideantur. (20) Noli igitur in conseruandis bonis uiris defetigari - non
cupiditate praesertim aliqua aut prauitate lapsis, sed opinione offici stulta
fortasse, certe non improba, et specie quadam rei publicae: non enim tua culpa
est si te aliqui timuerunt, contraque summa laus, quod minime timendum fuisse
senserunt.
VII. Nunc uenio ad grauissimam querelam et
atrocissimam suspicionem tuam, quae non tibi ipsi magis quam cum omnibus ciuibus
tum maxime nobis, qui a te conseruati sumus, prouidenda est: quam etsi spero
falsam esse, tamen numquam extenuabo uerbis. Tua enim cautio nostra cautio est,
ut si in alterutro peccandum sit, malim uideri nimis timidus quam parum prudens.
Sed quisnam est iste tam demens? De tuisne? - tametsi qui magis sunt tui quam
quibus tu salutem insperantibus reddidisti? - an ex hoc numero, qui una tecum
fuerunt? Non est credibilis tantus in ullo furor, ut quo duce omnia summa sit
adeptus, huius uitam non anteponat suae. An si nihil tui cogitant sceleris,
cauendum est ne quid inimici? Qui? omnes enim, qui fuerunt, aut sua pertinacia
uitam amiserunt, aut tua misericordia retinuerunt; ut aut nulli supersint de
inimicis, aut qui fuerunt sint amicissimi.
Sed tamen cum in animis hominum tantae
latebrae sint et tanti recessus, augeamus sane suspicionem tuam; simul enim
augebimus diligentiam. Nam quis est omnium tam ignarus rerum, tam rudis in re
publica, tam nihil umquam nec de sua nec de communi salute cogitans, qui non
intellegat tua salute contineri suam, et ex unius tua uita pendere omnium?
Equidem de te dies noctisque (ut debeo) cogitans, casus dumtaxat humanos et
incertos euentus ualetudinis et naturae communis fragilitatem extimesco;
doleoque, cum res publica immortalis esse debeat, eam in unius mortalis anima
consistere. Si uero ad humanos casus incertosque motus ualetudinis sceleris
etiam accedit insidiarumque consensio, quem deum, si cupiat, posse opitulari rei
publicae credamus?
VIII. Omnia sunt excitanda tibi, C. Caesar, uni,
quae iacere sentis, belli ipsius impetu, quod necesse fuit, perculsa atque
prostrata: constituenda iudicia, reuocanda fides, comprimendae libidines,
propaganda suboles: omnia, quae dilapsa iam diffluxerunt, seueris legibus
uincienda sunt. Non fuit recusandum in tanto ciuili bello, tanto animorum ardore
et armorum, quin quassata res publica, quicumque belli euentus fuisset, multa
perderet et ornamenta dignitatis et praesidia stabilitatis suae; multaque
uterque dux faceret armatus, quae idem togatus fieri prohibuisset. Quae quidem
tibi nunc omnia belli uolnera sananda sunt, quibus praeter te nemo mederi
potest.
Itaque illam tuam praeclarissimam et
sapientissimam uocem inuitus audiui: "Satis diu uel naturae uixi uel gloriae.''
Satis, si ita uis, fortasse naturae, addo etiam, si placet, gloriae: at, quod
maximum est, patriae certe parum. Qua re omitte istam, quaeso, doctorum hominum
in contemnenda morte prodentiam: noli nostro periculo esse sapiens. Saepe enim
uenit ad auris meas te idem istud nimis crebro dicere, tibi satis te uixisse.
Credo: sed tum id audirem, si tibi soli uiueres, aut si tibi etiam soli natus
esses. Omnium salutem ciuium cunctamque rem publicam res tuae gestae complexae
sunt: tantum abes a perfectione maximorum operum, ut fundamenta nondum quae
cogitas ieceris. Hic tu modum uitae tuae non salute rei publicae, sed aequitate
animi definies?
Quid, si istud ne gloriae tuae quidem satis
est? cuius te esse auidissimum, quamuis sis sapiens, non negabis. Parumne
igitur, inquies, magna relinquemus? Immo uero aliis quamuis multis satis, tibi
uni parum. Quicquid est enim, quamuis amplum sit, id est parum tum, cum est
aliquid amplius. Quod si rerum tuarum immortalium, C. Caesar, hic exitus futurus
fuit, ut deuictis aduersariis rem publicam in eo statu relinqueres in quo nunc
est, uide, quaeso, ne tua diuina uirtus admirationis plus sit habitura quam
gloriae: si quidem gloria est inlustris ac peruagata magnorum uel in suos uel in
patriam uel in omne genus hominum fama meritorum.
IX. Haec igitur tibi reliqua pars est: hic restat
actus, in hoc elaborandum est, ut rem publicam constituas, eaque tu in primis
summa tranquillitate et otio perfruare: tum te, si uoles, cum et patriae quod
debes solueris, et naturam ipsam expleueris satietate uiuendi, satis diu uixisse
dicito. Quid est enim (omnino) hoc ipsum diu, in quo est aliquid extremum? quod
cum uenit, omnis uoluptas praeterita pro nihilo est quia postea nulla est
futura. Quamquam iste tuus animus numquam his angustiis, quas natura nobis ad
uiuendum dedit, contentus fuit: semper immortalitatis amore flagrauit. Nec uero
haec tua uita ducenda est, quae corpore et spiritu continetur. Illa, inquam,
illa uita est tua, quae uigebit memoria saeculorum omnium, quam posteritas alet,
quam ipsa aeternitas semper tuebitur. Huic tu inseruias, huic te ostentes
oportet, quae quidem quae miretur iam pridem multa habet: nunc etiam quae laudet
exspectat.
Obstupescent posteri certe imperia, prouincias,
Rhenum, Oceanum, Nilum, pugnas innumerabilis, incredibilis uictorias, monimenta,
munera, triumphos audientes et legentes tuos. Sed nisi haec urbs stabilita tuis
consiliis et institutis erit, uagabitur modo tuum nomen longe atque late: sedem
stabilem et domicilium certum non habebit. Erit inter eos etiam qui nascentur,
sicut inter nos fuit, magna dissensio, cum alii laudibus ad caelum res tuas
gestas efferent, alii fortasse aliquid requirent, idque uel maximum, nisi belli
ciuilis incendium salute patriae restinxeris, ut illud fati fuisse uideatur, hoc
consili.
Serui igitur eis etiam iudicibus, qui multis post
saeculis de te iudicabunt, et quidem haud scio an incorruptius quam nos. Nam et
sine amore et sine cupiditate et rursus sine odio et sine inuidia iudicabunt. Id
autem etiam si tum ad te, ut quidam falso putant, non pertinebit, nunc certe
pertinet esse te talem, ut tuas laudes obscuratura nulla umquam sit obliuio.
X. Diuersae uoluntates ciuium fuerunt,
distractaeque sententiae. Non enim consiliis solum et studiis, sed armis etiam
et castris dissidebamus. Erat enim obscuritas quaedam; erat certamen inter
clarissimos duces: multi dubitabant quid optimum esset, multi quid sibi
expediret, multi quid deceret, non nulli etiam quid liceret. Perfuncta res
publica est hoc misero fatalique bello: uicit is, qui non fortuna inflammaret
odium suum, sed bonitate leniret; neque omnis quibus iratus esset, eosdem
(etiam) exsilio aut morte dignos iudicaret. Arma ab aliis posita, ab aliis
erepta sunt. Ingratus est iniustusque ciuis, qui, armorum periculo liberatus,
animum tamen retinet armatum; ut etiam ille melior sit qui in acie cecidit, qui
in causa animam profudit. Quae enim pertinacia quibusdam, eadem aliis constantia
uideri potest.
Sed iam omnis fracta dissensio est armis,
exstincta aequitate uictoris: restat ut omnes unum uelint, qui modo habent
aliquid non solum sapientiae, sed etiam sanitatis. Nisi te, C. Caesar, saluo, et
in ista sententia qua cum antea tum hodie uel maxime usus es manente, salui esse
non possumus. Qua re omnes te, qui haec salua esse uolumus, et hortamur et
obsecramus, ut uitae tuae et saluti consulas; omnesques tibi, ut pro aliis etiam
loquar quod de me ipse sentio, quoniam subesse aliquid putas quod cauendum sit,
non modo excubias et custodias, sed etiam laterum nostrorum oppositus et
corporum pollicemur.
XI. Sed, ut unde est orsa, in eodem terminetur
oratio, - maximas tibi omnes gratias agimus, C. Caesar, maiores etiam habemus.
Nam omnes idem sentiunt, quod ex omnium precibus et lacrimis sentire potuisti:
sed quia non est omnibus stantibus necesse dicere, a me certe dici uolunt, cui
necesse est quodam modo, et quod fieri decet - M. Marcello a te huic ordini
populoque Romano et rei publicae reddito - fieri id intellego. Nam laetari omnis
non de unius solum, sed de communi omnium salute sentio. Quod autem summae
beneuolentiae est, quae mea erga illum omnibus semper nota fuit, ut uix C.
Marcello, optimo et amantissimo fratri, praeter eum quidem cederem nemini, cum
id sollicitudine, cura, labore tam diu praestiterim, quam diu est de illius
salute dubitatum, certe hoc tempore, magnis curis, molestiis, doloribus
liberatus, praestare debeo. Itaque, C. Caesar, sic tibi gratias ago, ut omnibus
me rebus a te non conseruato solum, sed etiam ornato, tamen ad tua in me unum
innumerabilia merita, quod fieri iam posse non arbitrabar, maximus hoc tuo facto
cumulus accesserit. git. |
I. Enfin, Pères Conscrits,
ce jour a mis un terme au long silence que la
douleur, que le sentiment des convenances, et non la crainte,
m'avaient imposé
pendant ces dernières années. Je vais reprendre mon ancienne
habitude d'exprimer
mes voeux, mes sentiments. Une bonté si rare, une clémence si
extraordinaire,
cette modération admirable dans un pouvoir sans bornes, en un mot,
cette sagesse
incroyable et presque divine, ne me permettent pas d'étouffer la
voix de la
reconnaissance.
Oui, Pères Conscrits, lorsque
Marcellus est accordé à vos prières et aux voeux
de la république, il me semble que ma voix aussi et mes conseils
sont rendus et
conservés pour jamais à la patrie. Je gémissais ; je voyais avec une
douleur
extrême quelle était la différence de nos destinées, après que nous
avions l'un
et l'autre suivi la même cause. Je ne pouvais me résoudre à rentrer
seul dans
une carrière qui nous avait été commune, et je pensais que c'eût été
manquer à
tous les devoirs que d'y reparaître sans un ami,
243 l'émule,
l'imitateur, le
compagnon fidèle de mes travaux et de mes études. Ainsi donc, César,
vous avez à
la fois rouvert pour moi cette carrière fermée depuis longtemps, et
donné aux
sénateurs un gage certain de la prospérité publique, et comme le
signal de
l'espérance.
Ce que vous avez fait pour beaucoup
d'autres, et spécialement pour moi-même, ce
que vous venez de faire pour tous, en accordant Marcellus au sénat
et au peuple
romain, surtout après avoir rappelé le sujet de vos mécontentements,
est la
preuve la plus évidente que le voeu de cet ordre auguste et la
dignité de la
république l'emportent, auprès de vous, sur vos ressentiments et vos
soupçons.
Le suffrage unanime du sénat en faveur de ce grand citoyen, et la
justice
éclatante que vous lui rendez, lui ont fait recueillir en ce jour
tout le fruit
de sa vie passée. Vous sentez, César, à quel point un bienfait
honore celui qui
donne, quand il y a tant de gloire à recevoir. Mais en même temps,
combien
Marcellus est heureux que cette faveur ne cause pas moins de joie à
ses
concitoyens qu'il n'en ressentira lui-même ! Ces hommages de
l'affection
publique lui sont bien dus. Quel homme, en effet, est supérieur à
lui par la
naissance, par la probité, le goût des arts, l'innocence des moeurs,
enfin par
quelque genre de mérite que ce puisse être ?
II. Toute la fécondité du plus
beau génie, tous les efforts de l'éloquence et de
l'histoire s'épuiseraient en vain, je ne dirai point pour orner,
mais pour
raconter vos actions guerrières. Nulle d'elles cependant, j'ose le
dire devant
vous-même, César, ne vous procura jamais une gloire plus éclatante
que celle que
vous venez d'acquérir aujourd'hui. Une vérité qui souvent occupe ma
pensée, et
que, dans les épanchements de l'amitié, je me plais à répéter chaque
jour, c'est
que tous les hauts faits de nos généraux, des nations étrangères,
des peuples
les plus puissants, des monarques les plus célèbres, ne peuvent être
comparés
aux vôtres, soit que l'on considère la grandeur des intérêts, le
nombre des
combats, la variété des pays, la célérité de l'exécution, ou la
diversité des
guerres ; c'est enfin que nul voyageur n'a jamais traversé avec plus
de vitesse
les régions séparées par les plus longs intervalles, que vous ne les
avez
parcourues à la tête de vos légions victorieuses.
Que de tels exploits aient le droit
d'étonner l'imagination la plus hardie, la
folie seule pourrait le méconnaître : toutefois il est des choses
encore plus
grandes. En effet, les succès militaires ont des détracteurs ;
quelques hommes
contestent aux généraux une portion de cette gloire : ils en font la
part des
soldats, afin qu'elle ne demeure pas entière aux chefs qui les
commandent. Et
soyons vrais, la valeur des troupes, l'avantage des positions, les
secours des
alliés, les flottes, les convois, contribuent beaucoup à la
victoire. La fortune
surtout en réclame la plus grande partie ; et il n'est presque pas
de succès
qu'elle ne revendique comme son ouvrage.
Mais, César, la gloire qui vous est
acquise en ce jour, nul autre ne la partage
avec vous. Quelque grande qu'elle soit, et elle ne peut l'être
davantage, elle
est à vous, oui, tout entière à vous seul. Centurion, préfet,
soldat, nul n'a
droit de détacher un seul laurier d'une si belle couronne. La
Fortune elle-même,
cette maîtresse des choses humaines, n'ose rien y prétendre ; elle
vous la cède
; elle confesse qu'elle vous est propre, qu'elle n'appartient qu'à
vous. Jamais,
en effet, 244 la témérité ne s'allie avec la sagesse, et le hasard n'est
pas admis
aux conseils de la prudence.
III. Vous avez dompté des nations
barbares, innombrables, répandues dans de
vastes contrées, inépuisables en ressources ; mais enfin, ces
nations que vous
avez vaincues, ni la nature ni leur destinée ne les avaient faites
invincibles.
Il n'est point de force qui ne, puisse être ébranlée et brisée par
le fer et les
efforts. Mais se vaincre soi-même, réprimer sa colère, modérer la
victoire,
tendre une main secourable à un adversaire distingué par la
noblesse, par le
talent, par la vertu, le relever, le placer même dans un plus haut
rang, c'est
faire plus qu'un héros, c'est s'égaler à la divinité.
Sans doute, César, vos actions
guerrières seront célébrées non seulement dans
nos fastes, mais dans les annales de presque toutes les nations :
elles
deviendront l'éternel entretien des générations futures. Cependant,
lorsque nous
lisons le récit des batailles et des victoires, il semble que nous
soyons encore
troublés par le cri des soldats et par le son des trompettes. Si, au
contraire,
nous lisons ou si nous entendons raconter une action de clémence, de
douceur, de
justice, de modération, de sagesse, surtout quand elle a été faite
dans la
colère, toujours ennemie de la raison, ou dans la victoire,
naturellement
insolente et cruelle, par quelle douce impulsion nous sentons-nous
portés, même
dans les récits fabuleux, à chérir des personnes que nous n'avons
jamais vues !
Mais vous, que nos regards contemplent, vous, dont nous voyons que
les pensées
et les désirs n'ont d'autre but que de conserver à la patrie ce que
le malheur
de la guerre ne lui a pas ravi, quelles acclamations vous prouveront
notre
reconnaissance ? quels seront les transports de notre zèle ? quel
sera
l'enthousiasme de notre amour ? Ah ! César ! il me semble que,
tressaillant
eux-mêmes de joie, ces murs veulent prendre la parole, et vous
rendre grâces de
ce que bientôt ils verront ce vertueux citoyen remonter sur ces
sièges que
lui-même et ses ancêtres ont si dignement occupés.
IV. Pour moi, lorsque j'ai vu
couler ici les larmes de C. Marcellus, ce parfait
modèle de la tendresse fraternelle, le souvenir de tous ces grands
hommes a
pénétré mon âme. En conservant M. Marcellus, vous leur avez rendu,
même après le
trépas, tout l'éclat de leur antique splendeur ; vous avez sauvé de
la mort
cette illustre famille, qui déjà ne vit plus que dans un petit
nombre de
rejetons. C'est donc à juste titre que vous
mettrez cette seule journée au-dessus de vos
innombrables triomphes. Ce que vous venez de faire est l'ouvrage de
vous seul.
Nul doute que les victoires remportées sous vos ordres ne soient
éclatantes ;
mais de nombreux guerriers ont secondé votre courage. Ici vous êtes
à la fois et
la tête qui commande, et le bras qui exécute. La durée de vos
trophées et de vos
monuments ne peut être éternelle ; ouvrages des hommes, ils sont
mortels comme
eux ; mais cette justice et cette bonté, dont vous donnez un si rare
exemple,
brilleront chaque jour d'un nouvel éclat, et ce que les années
feront perdre à
vos monuments, elles l'ajouteront à votre gloire.
Déjà vous avez surpassé en modération
et en clémence tous ceux qui furent
vainqueurs dans 245 des guerres civiles : aujourd'hui vous vous êtes
surpassé
vous-même. Je crains de ne pouvoir exprimer ma pensée telle que je
la conçois :
vous me semblez avoir vaincu la victoire même, en remettant aux
vaincus les
droits qu'elle avait acquis sur eux. Par les lois de la victoire,
nous eussions
tous péri justement ; l'arrêt de votre clémence nous a tous
conservés. Ainsi
donc, à vous seul appartient le titre d'invincible, puisque vous
avez triomphé
des droits et de la force de la victoire.
V. Et remarquez, Pères Conscrits,
quelles sont les heureuses conséquences de ce
jugement de César. Ceux de nous qu'un destin malheureux et funeste
entraîna dans
cette guerre, ont, sans contredit, à se reprocher une de ces erreurs
qui sont
inséparables de l'humanité ; mais du moins notre innocence est
solennellement
reconnue. En effet, lorsque César, touché de vos prières, a conservé
Marcellus à
la république ; lorsque sa bonté, prévenant toutes les
sollicitations, m'a rendu
à moi-même et à ma patrie, ainsi que tant d'autres citoyens
illustres que vous
voyez autour de vous, il n'a point placé dans le sénat les ennemis
du nom romain ;
il a jugé que la plupart avaient pris les armes par l'effet d'une
erreur ou
d'une crainte vaine et chimérique, plutôt que par aucun motif
d'ambition ou de haine.
Pour moi, dans le cours de nos
dissensions, j'ai toujours pensé qu'il fallait
s'occuper de la paix, et j'ai vu avec douleur qu'on la rejetât,
qu'on refusât
même d'écouter ceux qui la réclamaient avec instance. Mon bras ne
s'est armé, ni
dans cette guerre civile, ni dans aucune autre ; et mes conseils,
toujours amis
de la paix et de la concorde, n'inspirèrent jamais la haine et les
combats. J'ai
suivi dans Pompée un ami, et non pas un chef : tel était sur mon
coeur le
pouvoir de la reconnaissance, que, sans intérêt et même sans espoir,
je courais
volontairement au précipice. Je n'ai point dissimulé ma pensée :
car, dans ce lieu même, avant qu'on eût pris
les armes, j'ai parlé fortement pour la paix ; et durant la guerre,
au péril de
mes jours, j'ai constamment tenu le même langage. On ne pourrait
donc, sans
injustice, douter de l'opinion de César sur la guerre, après qu'on
l'a vu
s'empresser de sauver les amis de la paix, et se montrer plus sévère
envers les
autres. Sa conduite pouvait sembler moins étonnante, lorsque
l'événement était
douteux et le succès incertain ; mais, après la victoire, marquer un
si vif
intérêt à ceux qui voulaient la paix, c'est faire assez connaître
qu'on aurait
mieux aimé ne pas combattre que de vaincre.
VI. J'affirme que tels étaient
aussi les principes de Marcellus. Dans la guerre
et dans la paix, nous fûmes toujours unis de sentiments. Combien de
fois l'ai-je
vu frémir de l'insolence de certains hommes, et redouter les fureurs
de la
victoire elle-même ! Témoins de leurs menaces, César, nous en devons
mieux
sentir le prix de votre générosité ; car ce ne sont plus les causes,
ce sont les
victoires qu'il faut comparer ensemble. La vôtre ne s'est pas étendue au delà
du combat ; Rome n'a pas vu un seul glaive
hors du fourreau. Les citoyens que nous avons perdus, c'est le fer
des
combattants, et non la colère du vainqueur, qui les a frappés ; et
nul doute que
César, s'il était possible, n'en rappelât un grand nombre à
246 la vie,
puisqu'il
conserve de cette même armée tous ceux qu'il peut sauver. Quant à
l'autre parti,
je ne dirai que ce que nous craignions tous : la vengeance aurait
ensanglanté la
victoire. On menaçait et ceux qui s'étaient armés, et ceux même qui
étaient
restés neutres ; on disait qu'il fallait examiner, non ce que chacun
avait
pensé, mais en quels lieux il s'était trouvé. D'où je crois pouvoir
conclure
que, si les dieux ont voulu punir le peuple romain en suscitant une
guerre
civile si funeste et si désastreuse, ces dieux sont apaisés, ou
qu'ils sont
enfin rassasiés de nos malheurs, puisqu'ils ont remis le soin de
notre salut à
la sagesse et à la clémence du vainqueur.
Applaudissez-vous donc, César, d'un si
précieux avantage ; jouissez de votre
bonheur, de votre gloire, et surtout de la bonté de votre caractère
: il n'est
pas pour le sage de récompense plus douce, ni de jouissance plus
délicieuse.
Quand vous vous rappellerez vos actions guerrières, vous aurez à
vous féliciter
souvent de votre valeur, mais plus souvent encore de votre heureuse
fortune :
toutes les fois que vous penserez à tant de citoyens qu'il vous a
plu de
conserver avec vous dans la république, ce souvenir vous retracera
sans cesse
vos inappréciables bienfaits, votre générosité incroyable, votre
sagesse
supérieure : ce sont là les plus grands biens, j'ose dire les seuls
biens de
l'homme. Tel est, en effet, l'éclat de la vraie gloire, telle est la
majesté de
la grandeur d'âme et de la noblesse des sentiments, qu'elles seules
paraissent
être un don de la vertu ; le reste n'est qu'un prêt de la fortune.
Ainsi ne vous lassez pas de conserver des hommes vertueux, persuadé
qu'ils ont
failli, non pas entraînés par l'ambition ou par quelque autre
passion coupable,
mais séduits par une apparence de bien public, par une idée de
devoir, mal
entendue sans doute, mais qui du moins n'avait rien de criminel. Si
quelques-uns
ont conçu des craintes, la faute ne peut vous en être imputée : mais
que le plus
grand nombre, au contraire, ait pensé n'avoir rien à craindre de
vous, c'est là
votre plus grande gloire.
VII. Je passe maintenant à ces
plaintes amères, à ces horribles soupçons qui
doivent exciter vos sollicitudes et celles de tous les citoyens, de
nous surtout
qui vous devons la vie. Je les crois peu fondés, mais je me garderai
de les
affaiblir ; car, en veillant à vos jours, vous assurerez les nôtres,
et, s'il
faut pécher par quelque excès, j'aime mieux être trop timide que de
n'être pas
assez prudent. Toutefois quel furieux voudrait... ? Un des vôtres ?
Eh ! quels
hommes ont mieux mérité ce nom, que ceux à qui vous avez rendu la
vie qu'ils
n'osaient espérer ? Serait-ce quelqu'un de ceux qui ont suivi vos
drapeaux ? Un
tel excès de démence n'est pas croyable. Pourraient-ils balancer à
se sacrifier
eux-mêmes pour un chef dont les bienfaits ont comblé tous leurs
voeux ? Mais ne
faut-il pas du moins vous prémunir contre vos ennemis ? Eh ! quels
sont-ils ?
Tous ceux qui le furent ont perdu la vie par leur opiniâtreté, ou
l'ont
conservée par votre clémence. Vos ennemis ne sont plus, ou, si
quelques-uns ont
survécu, ils sont devenus vos amis les plus fidèles.
Cependant, comme il y a dans le coeur
humain tant de replis secrets et de
détours cachés, redoublons vos soupçons ; par là nous redoublerons
247 votre
vigilance. Mais est-il un homme assez étranger aux affaires, et qui
réfléchisse
assez peu sur son propre intérêt et sur celui de la patrie, pour ne
pas
comprendre que son existence est attachée à la vôtre, et que de la
vie de César
dépend la vie de tous les citoyens ? Moi qui me fais un devoir de
m'occuper de
vous et le jour et la nuit, je ne redoute pour vous que les
accidents de
l'humanité, les dangers des maladies et la fragilité de notre nature
; et je
frémis quand je songe que de l'existence d'un seul mortel dépend le
destin d'un
empire fondé pour l'éternité. Si aux accidents humains et aux
dangers des
maladies venaient se joindre encore les crimes et les complots, quel
dieu, quand
il le voudrait, pourrait secourir la république ?
VIII. César, c'est à vous seul
qu'il appartient de relever toutes les ruines de
la guerre, de rétablir les tribunaux, de rappeler la confiance, de
réprimer la
licence, de favoriser la population, enfin de réunir et lier
ensemble par la
vigueur des lois tout ce que nous voyons dissous et dispersé. Dans
une guerre
civile aussi acharnée, dans une telle agitation des esprits, quel
que dût être
le succès, il était inévitable que la république ébranlée ne vit
s'écrouler
plusieurs des soutiens de sa gloire et de sa puissance, et que les
deux chefs ne
fissent, étant armés, ce qu'ils auraient empêché de faire dans un
état de calme
et de paix. Il faut aujourd'hui cicatriser les plaies de la guerre,
et nul autre
que vous ne peut les guérir.
Aussi vous ai-je entendu avec peine
prononcer ces mots pleins de grandeur et de
philosophie : « J'ai assez vécu, soit pour la nature, soit pour la
gloire. » Oui,
peut-être assez pour la nature ; assez même, si vous le voulez, pour
la gloire :
mais la patrie, qui est avant tout, vous avez certes trop peu vécu
pour elle.
Laissez donc aux philosophes ce stoïque mépris de la mort ;
n'aspirez pas à une
sagesse qui nous serait funeste. Vous répétez trop souvent que vous
avez assez
vécu pour vous. Moi-même j'applaudirais à cette parole, si vous
viviez, si vous
étiez né pour vous seul. Aujourd'hui vos exploits ont remis en vos
mains le
salut de tous les citoyens et la république entière ; et loin
d'avoir achevé le
grand édifice du bonheur public, vous n'en avez pas encore assuré
les
fondements. Et c'est en ce moment que vous mesurerez la durée de vos
jours, non
sur le besoin de l'État, mais sur la modération de votre âme l
Que
dis-je ?
avez-vous même assez vécu pour la gloire ? tout philosophe que vous
êtes, vous
ne nierez pas que vous ne l'aimiez avec passion. Eh bien ! direz-vous, laisserai-je peu
de gloire après moi ? Beaucoup, César, et
même assez pour plusieurs autres ensemble, mais trop peu pour vous
seul. Quelque
grande que soit la carrière qu'on a parcourue, c'est peu de chose,
s'il reste
encore un plus long espace à parcourir. Si, vous bornant à triompher
de vos
adversaires, vous laissez la république dans l'état où elle est ; si
telle doit
être l'unique fin de tant d'actions immortelles, prenez garde que
votre héroïque
valeur n'ait plutôt excité l'admiration que mérité la gloire ; car
enfin la
gloire est une renommée éclatante et sans bornes, acquise par de
grands et de
nombreux services rendus aux siens, à sa patrie, à l'humanité
entière.
248 IX. Ce qui vous reste à faire,
c'est de donner à la république une constitution
durable, et de jouir vous-même du calme et du repos que vous lui
aurez assurés :
voilà ce qui doit couronner vos travaux, et quel doit être le terme
de vos
efforts. Alors, quitte envers la patrie et rassasié d'années, dites,
si vous
voulez, que vous avez assez longtemps vécu. Assez longtemps !
pouvons-nous
parler ainsi d'une durée si courte, et dont le terme anéantit tous
les plaisirs
passés, puisqu'ils sont alors finis sans retour ? Mais quoi ! votre
grande âme
se resserra-t-elle jamais dans ces bornes étroites que la nature a
marquées à la
vie de l'homme ? Non, elle brûla toujours du désir de l'immortalité.
Pour César,
la vie n'est pas cet instant fugitif pendant lequel l'âme est unie
au corps ; la
vie, pour César, est cette existence qui se perpétuera par le
souvenir de tous
les siècles, qui se prolongera dans les âges les plus reculés, et
qui n'aura
d'autres limites que l'éternité même. C'est pour cet avenir qu'il
faut
travailler ; c'est à lui qu'il faut montrer votre gloire. Dès
longtemps vous
avez assez fait pour qu'il admire ; il attend aujourd'hui que vous
le forciez à
louer vos bienfaits.
Certes, vos commandements, vos
provinces, le Rhin, l'Océan, le Nil, domptés par
vos armes, vos combats sans nombre, vos incroyables victoires, la
magnificence
do vos monuments, de vos fêtes et de vos triomphes, étonneront la
postérité.
Mais, si Rome n'est pas affermie par la sagesse de vos lois et de
vos
institutions, votre nom errant, pour ainsi dire, dans toutes les
parties du
monde, n'aura jamais une demeure fixe, un domicile assuré. Ceux qui
vivront
après nous seront partagés comme nous l'avons été : les uns
élèveront vos
exploits jusqu'aux cieux ; les autres regretteront de n'y pas voir
la chose la
plus essentielle peut-être, si, en sauvant la patrie, vous
n'éteignez l'incendie
de la guerre civile ; et ils diront que le reste a pu être l'ouvrage
du destin,
tandis que cette gloire n'aurait appartenu qu'à vous.
Travaillez donc pour ces juges qui,
dans la suite des âges, prononceront sur
vous avec plus d'équité que nous ne le pouvons faire, parce que
l'amour et la
faveur, la haine et la jalousie n'influeront nullement sur leurs
suffrages.
Dussiez-vous même alors, ainsi que le prétendent certains sophistes,
être
insensible à tout ce qu'on dira de vous, au moins il vous importe
aujourd'hui de
mériter une gloire que le temps n'obscurcira jamais.
X. Les citoyens ont été divisés de volontés et de sentiments ;
et ce n'a pas été
seulement une lutte d'opinions et de passions opposées. On s'est
armé ; on s'est
rangé sous des étendards ennemis. Un voile épais cachait la vérité ;
des chefs
illustres se combattaient ; et, dans ce désordre extrême, justice,
intérêt,
devoir, droits même, tout était obscur et incertain. La république
est délivrée
de cette horrible guerre : la victoire est demeurée à celui dont la
colère, loin
d'être enflammée par le succès, devait être fléchie par la clémence,
et qui n'a
pas jugé dignes de l'exil ou de la mort ceux qui l'avaient irrité.
Les uns ont
déposé les armes, les autres ont été désarmés par la force. Garder
un coeur armé
lorsqu'on n'a plus rien à craindre des armes, c'est joindre
l'injustice à
l'ingratitude. Celui qui a péri sur le champ de bataille en se
sacrifiant pour
sa cause est bien plus digne d'excuse ; car ce que les uns nom-
249 ment
opiniâtreté,
d'autres l'appellent constance.
Enfin, les armes ont étouffé les
dissensions, et la modération du vainqueur les
a toutes anéanties. Il est désormais nécessaire que tous les hommes
raisonnables
n'aient qu'une seule volonté. César, point de salut pour nous si
vous ne vivez,
et si vous ne persistez dans les sentiments dont vous avez donné
tant de fois,
et surtout aujourd'hui, des preuves si éclatantes. Tous ceux qui
veulent le
salut de l'Etat vous pressent donc et vous conjurent de prendre soin
de vos
jours ; et, puisque vous croyez avoir quelque péril à craindre, nous
vous
offrons tous, car c'est au nom de tous que je prends cet engagement,
nous vous
offrons de veiller autour de votre personne, de vous faire un
rempart de nos
corps, et de nous jeter au-devant des coups qu'on voudrait vous
porter.
XI. Mais je reviens au premier
objet de ce discours. César, nous vous présentons
les hommages de la plus vive reconnaissance ; les paroles me
manquent pour
exprimer combien nos coeurs sont pénétrés. Tous les sénateurs ont
les mêmes
sentiments que moi, et vous avez pu en juger par leurs prières et
par leurs
larmes. Mais comme il n'est pas nécessaire que tous prennent la
parole, ils
veulent que je sois leur interprète auprès de vous. Leur volonté
m'en fait une
loi ; et lorsque Marcellus est rendu au sénat, au peuple romain et à
la
république, je sens que c'est à moi surtout de remplir ce devoir. En
effet, les
autres voient dans cette faveur un bienfait qui s'étend sur tous les
citoyens ;
mais l'amitié qu'on m'a toujours connue pour lui, et qui le cède à
peine à celle
de C. Marcellus, le plus tendre et le plus sensible des frères, me
rend ce
bienfait plus précieux encore. Après que je l'ai prouvée par les
inquiétudes,
les soucis et les chagrins dont mon coeur était affligé tant qu'on a
pu douter
du sort de Marcellus, il est juste qu'elle éclate aujourd'hui que je
suis
délivré de ces agitations et de ces alarmes. Ainsi donc, César,
recevez les
notions de grâces de celui qui, maintenu dans ses anciennes
dignités, et revêtu
de nouveaux honneurs par votre clémence, à l'instant même où il ne
croyait pas
que l'on pût rien ajouter à de si nombreuses faveurs répandues sur
un seul
homme, vous voit, par cette action généreuse, mettre le comble à
tant de bienfaits. |