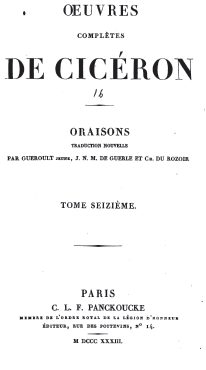
CICÉRON
DOUZIÈME PHILIPPIQUE.
DOUZIÈME PHILIPPIQUE
|
I. Quoiqu'il paraisse bien peu convenable, Pères conscrits, de voir faillir, s'abuser, tomber dans l'erreur celui dont, en des affaires importantes, vous adoptez souvent l'avis, je me console toutefois par l'idée que, tout comme vous, tout comme le plus sage consul, j'ai pu errer. Deux consulaires étaient venus nous apporter l'espoir d'une paix honorable : amis intimes de M. Antoine et pour ainsi dire de sa maison, ils nous semblaient devoir dans sa position quelque blessure cachée à nos yeux. Chez l'un sont l'épouse et les enfants d'Antoine ; l'autre chaque jour lui envoie et en reçoit des lettres, et le favorise ouvertement. Tous deux, soudainement, se sont mis à nous exhorter à la paix, ce dont, depuis longtemps, ils s'étaient abstenus ; et nous n'avons pu croire qu'ils le fissent sans motif. Le consul est venu se joindre à leurs exhortations; et quel consul! Cherche-t-on un modèle de prudence? il est à l'abri de toute surprise ; de courage? il est incapable d'admettre aucune paix, sans la soumission préalable d'Antoine ou sa défaite; de grandeur d'âme? Il préférerait la mort à l'esclavage. Vous-mêmes, Pères conscrits, vous n'avez pas paru oublier la sévérité de vos décrets; mais, acceptant l'espoir de la soumission d'Antoine (ce que ses amis appelaient faire sa paix), vous vous disposiez à imposer des conditions et non à en recevoir. Ce qui fortifiait mon espérance, et, je crois, aussi la vôtre, c'est qu'on me disait que la maison d'Antoine était plongée dans la douleur, et sa femme dans la désolation. Ici même, les partisans d'Antoine, et mes yeux ne quittent pas leurs visages, me paraissent plus tristes. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi, de la part de Pison, et de Calenus surtout, pourquoi, dans le moment actuel, pourquoi tant à l'improviste, pourquoi si subitement cette ouverture pour la paix? Pison dit qu'il ne sait rien, qu'il n'a rien appris ; Calenus dit que rien de nouveau n'est venu à sa connaissance. Et ils se tiennent dans ce système négatif, à présent qu'ils nous croient liés par ce projet de députation pour la paix. Est-il donc besoin de prendre une nouvelle détermination, si, dans la situation des affaires il n'est rien survenu de nouveau? II. On nous a trompés, oui, trompés, Pères conscrits ; c'est la cause d'Antoine que ses amis ont plaidée, et non pas celle de l'État. C'est bien ce que je voyais, mais comme à travers un nuage : les yeux de mon esprit s'étaient laissé fasciner par ma préoccupation pour le salut de D. Brutus. Ah ! si, dans la guerre, on pouvait servir de substitut, combien volontiers, pour que D. Brutus fût délivré, je me ferais assiéger à sa place ! Mais voici les paroles de Calenus qui nous ont abusés : « Quoi! s'il s'éloignait de Modène, n'écouterions-nous pas Antoine? ne l'écouterions-nous pas même, s'il promettait de rentrer sous l'autorité du sénat? » Cette rigueur nous parut excessive : nous nous sommes laissé fléchir; nous avons cédé. Mais s'est-il éloigné de Modène? "Je l'ignore", dit Calenus. Se soumettra-t-il au sénat? "Je le crois", répond-il, "pourvu qu'il ne compromette pas son honneur". A merveille, Pères conscrits; résignez-vous au sacrifice de votre honneur, si éminent, si précieux ; et celui d'Antoine, qui n'existe et ne peut exister, ménagez-le : que par vous il le recouvre, après l'avoir perdu par son fait. Si, terrassé par une défaite, il réclamait de vous une sorte de capitulation, je l'écouterais peut-être; quoique, après tout ... Mais je reviens à mon premier avis, oui, je l'écouterais. Il est debout, il faut lui résister, ou il faut, avec notre honneur, lui sacrifier notre liberté. Mais on ne peut revenir sur ce qu'on a fait. Une députation a été décrétée. Eh bien ! défendez-vous au sage de revenir sur ses pas quand il peut encore réparer sa faute? Tout homme est sujet à l'erreur; il n'appartient qu'à l'insensé d'y persévérer. Les secondes pensées, dit-on, sont ordinairement les plus sages. Il est dissipé, ce nuage dont je parlais tout à l'heure : le jour luit, tout se découvre à nos yeux ; nous voyons tout, non seulement par nous-mêmes, mais par les admonitions de nos amis. Vous venez d'entendre les paroles de notre illustre collègue : «J'ai trouvé, a-t-il dit, ma maison, ma femme, mes enfants dans la tristesse. Les gens de bien s'étonnaient, mes amis me reprochaient d'avoir, dans l'espoir de la paix, accepté la députation.» Et cela ne me surprend pas, P. Servilius; car c'est grâce à vos amis aussi judicieux que sévères. qu'Antoine s'est vu dépouillé, je ne dis pas de toute considération, mais de tout espoir de salut. Vous, aller vers lui en députation ! qui ne s'en étonnerait? Je puis en juger par moi-même, moi, dont l'avis, qui était le vôtre, est, je le sais, si généralement blâmé. Sommes-nous blâmés seuls? Quoi ! Pansa, cet homme si ferme, est-ce sans motif qu'avec des expressions si mesurées il vient de parler si longtemps? Quel était son but, sinon d'écarter de sa personne tout soupçon de trahison, même le moins fondé? Et d'où pourrait naître ce soupçon? De son zèle inattendu à se faire le champion de la paix, rôle dont il s'est chargé tout d'un coup, séduit qu'il était par la même erreur que nous. Que si nous nous sommes laissé égarer, Pères conscrits, par les fausses lueurs d'une espérance fallacieuse, rentrons dans la vraie route. Le port le plus assuré pour l'homme qui se repent, consiste à adopter une autre marche. III. Car enfin, j'en atteste les dieux immortels, en quoi peut être utile à la république notre députation? Je dis utile! que serait-ce donc si elle devait lui être nuisible? Eh ! que parlé-je au futur? ne lui a-t-elle pas nui déjà? Et croyez-vous que cette ardeur si vive et si prononcée du peuple romain pour recouvrer sa liberté, n'a pas été modérée, ralentie par la nouvelle d'une députation pacifique? Que pensez-vous de l'effet qu'elle aura produit sur les municipes, sur nos colonies? Et l'Italie entière, pensez-vous qu'elle conservera toujours cette ardeur dont elle était enflammée pour éteindre l'incendie commun ? Devons-nous penser qu'elles ne se repentiront pas d'avoir déclaré, signalé leur haine contre Antoine, les populations qui nous ont promis de l'argent, des armes, qui se sont tout entières, corps et âme, dévouées à la république? Comment votre résolution obtiendrait-elle l'approbation de Capoue, qui, dans ces derniers temps, a été une autre Rome? Par elle des citoyens parricides ont été condamnés, rejetés, bannis. C'est elle, oui, c'est Capoue qui, en dépit des généreux efforts de ses habitants, a vu arracher Antoine de ses mains. Et nos légions, n'allons-nous pas encore, par tous ces projets nouveaux, leur couper les nerfs? Quel est, en effet, l'homme qui s'enflammera d'ardeur pour la guerre, si vous lui offrez l'espérance de la paix? La légion de Mars elle-même, cette légion céleste et divine, sentira, à cette nouvelle, s'alanguir et mollir son énergie, et ce nom si beau de soldats de Mars, elle le perdra. Ses armes, ses épées lui tomberont des mains. Combattant pour la cause du sénat, elle ne croira pas devoir se montrer plus constante dans sa haine contre Antoine que le sénat lui-même. Je rougis en pensant à cette légion, je rougis en songeant à la quatrième, qui, mettant la même énergie à soutenir notre autorité, n'a plus vu dans Antoine un consul ni son général, mais l'ennemi et l'agresseur de la patrie, et l'a abandonné; je rougis en pensant à cette excellente armée qui s'est formée de la réunion de deux autres, qui, après avoir été passée en revue, est déjà partie pour Modéne, et qui, lorsque la nouvelle de la paix ou plutôt de notre peur lui parviendra, reculera peut-être, ou du moins suspendra sa marche. Qui, en effet, lorsque le sénat rappellera les troupes et sonnera la retraite, s'empressera de combattre? IV. Quoi, d'ailleurs, de plus injuste de notre part que d'aller, à l'insu de ceux qui soutiennent la guerre, décider ici de la paix? Que dis-je, à leur insu? même contre leur gré. Quoi donc! A. Hirtius, cet illustre consul; C. César que le bienfait des dieux a fait naître dans les conjonctures présentes, ces deux chefs dont les lettres sont remplies de leurs espérances de victoire, et ces lettres, je les ai entre les mains, pensez-vous qu'ils veuillent la paix? Vaincre, voilà ce qu'ils souhaitent ; et ce doux, ce beau nom de la paix, ils l'invoquent non par un traité, mais par la victoire. Et la Gaule, comment croyez-vous qu'elle accueillera la nouvelle de ce qui se passe ici? C'est elle en effet qui, pour repousser, diriger, soutenir cette guerre, a la première donné l'impulsion et l'exemple. Oui, la Gaule, obéissant au premier signe de D. Brutus, sans même attendre ses ordres, a, par ses armes, ses guerriers, ses subsides, assuré le succès des premières opérations ; elle a de plus à la cruauté de M. Antoine opposé son corps tout entier : elle est épuisée, dévastée, incendiée, et sans regret elle souffre tous les maux de la guerre, pourvu qu'à ce prix elle repousse la servitude qui la menace. Et sans parler des autres parties de la Gaule, car toutes ont un zèle égal, on a vu les habitants de Padoue, ou chasser, ou refuser de recevoir les envoyés d'Antoine : argent, soldats et, ce qui était surtout nécessaire, armes, ils ont mis toutes choses à la disposition de nos généraux ; cet exemple a été suivi par tous ces mêmes peuples qui autrefois se coalisèrent pour un intérêt commun, et que, vu les refus réitérés du sénat pendant plusieurs années, on eût pu croire mal disposés à son égard. Nous ne devons pas, maintenant qu'ils participent aux droits de la république, nous étonner de les trouver fidèles, eux qui, lors même qu'ils n'en jouissaient pas, nous ont toujours prouvé une fidélité inviolable. Ainsi, lorsque, tous tant qu'ils sont, l'espoir de la victoire les anime, nous irions leur faire entendre le mot de paix, ou plutôt de découragement! V. Que sera-ce, si toute paix est impossible ? En effet, quelles conditions peut-on faire avec celui à qui, même en cas de paix, on ne pourrait faire aucune concession? Maintes démarches de notre part ont invité Antoine à la paix; il a préféré la guerre. Des députés lui ont été envoyés, bien contre mon avis; mais enfin on les a envoyés. On lui a transmis vos ordres; il n'a point obéi. On lui a signifié qu'il eût à ne plus tenir Brutus assiégé, à s'éloigner de Modène; il a pressé ses attaques avec plus d'ardeur. Et nous enverrons un message de paix à celui qui a rejeté les médiateurs de la paix! Croirait-on que, devant nous, il se montrera plus réservé dans ses demandes, qu'il ne le fut alors qu'il envoya ses propositions au Sénat? Cependant, quelque révoltantes que fussent alors ses prétentions, il y avait au moins possibilité d'y souscrire : il n'avait pas encore été frappé, flétri par vos sévères et infamants décrets. Aujourd'hui il demande ce que nous ne pouvons en aucune façon lui concéder, sans nous confesser préalablement vaincus par les armes. Les sénatus-consultes publiés par lui, nous les avons jugés faux. Pouvons-nous aujourd'hui les reconnaître pour véritables ? Ses lois, nous l'avons déclaré, ont été portées par violence et contre les auspices ; elles ne sont obligatoires ni pour le peuple ni pour la dernière classe des citoyens. Pensez-vous que nous puissions en proclamer la validité? Sept cent millions de sesterces ont été, vous l'avez reconnu, détournés du trésor public par Antoine. Peut-on faire qu'il ne soit atteint et convaincu de péculat? Des immunités pour les villes, des sacerdoces, des royaumes ont été vendus par lui : affichera-t-on de nouveau ces décrets que vos sénatus-consultes ont fait arracher? VI. Et quand nous voudrions annuler nos décrets, pourrons-nous aussi en effacer la mémoire? La postérité oubliera-t-elle jamais les attentats de l'homme qui nous a forcés de revêtir ce funeste habit de guerre? Quand le sang des centurions de la légion de Mars, par lui versé à Brindes, pourrait s'effacer, pourra-t-on effacer la publication de cet acte de cruauté? Mais omettons les faits qui se sont passés depuis, la main du temps effacera-t-elle jamais les sinistres monuments de ses ouvrages de siége autour de Modène, les indices de ses forfaits, les traces de son brigandage? A ce parricide impur et effréné, quelle concession pouvons-nous faire, au nom des dieux immortels? La Gaule Ultérieure et une armée? Ce sera là moins faire la paix que différer la guerre; et ce ne sera pas seulement proroger la guerre, mais même lui céder la victoire; car ne sera-ce pas pour lui une victoire, que de pouvoir, à quelque condition que ce soit, entrer dans Rome avec son cortége? Grâce à nos armes, nous sommes maintenant maîtres de tout ; notre autorité l'emporte ; loin de nous sont tant de citoyens pervers qui ont suivi leur digne chef; et cependant l'aspect et les discours de ceux d'entre eux qui restent encore à Rome sont pour nous un supplice. Que sera-ce, dites-moi, lorsque tous à la foi ils y feront invasion? Nous, nous aurons posé les armes, eux n'en auront rien fait. Ne serons-nous pas, par l'effet de nos propres résolutions, vaincus pour toujours? Que vos yeux se représentent M. Antoine consulaire, joignez-y Lucius aspirant au consulat: joignez-y tous les autres, même ceux qui ne sont pas de notre ordre, rêvant les commandements et les honneurs; gardez-vous alors de faire fi même des Tiron Numisius, des Mustella ou des Saxa : la paix faite avec eux ne sera pas une paix, mais un pacte de servitude. L. Pison, cet éminent personnage, a dit une belle parole qui a été de votre part, Pansa, non seulement dans cette enceinte, mais dans l'assemblée du peuple, l'objet d'un éloge mérité : «Je sortirais d'Italie; j'abandonnerais mes dieux pénates et la demeure de mes pères, si (ce qu'aux dieux ne plaise! la république était asservie par Antoine!» VII. Je vous le demande donc, Pison, la république ne sera-t-elle pas, à votre sens, asservie, si tant d'hommes sacrilèges, audacieux, capables de tous les forfaits, sont reçus au milieu de nous? Déjà, quand ils n'étaient pas encore souillés de tant de parricides, nous avions peine à les supporter ; pensez-vous que, aujourd'hui qu'ils sont couverts de tous les crimes, nous puissions les tolérer dans Rome? Ou il faut, croyez-moi, recourir au sage conseil que vous donniez, nous éloigner, nous exiler, nous condamner pour toujours à une vie errante et misérable, ou présenter la gorge à ces brigands, et succomber au sein de la patrie. Où sont, C. Pansa, vos exhortations généreuses, alors que, stimulant le sénat, enflammant le peuple, vous leur disiez, vous leur prouviez qu'il n'est rien pour un Romain de plus honteux que la servitude? N'avons-nous donc revêtu l'habit de guerre, pris les armes, appelé sous les drapeaux la jeunesse de toute l'Italie, formé l'armée la plus brillante et la plus nombreuse, qu'afin d'envoyer des députés pour la paix? Si c'est pour en dicter les conditions, qu'avons-nous à craindre? Si c'est pour les recevoir, ne doit-on pas nous les demander? Et moi, serai-je de cette députation? dois-je faire partie d'un conseil dans lequel, en cas que je ne partageasse pas l'opinion de mes collègues, le peuple romain ne pourrait en être instruit. Il s'ensuivra que si l'on faiblit, si l'on fait quelques concessions, j'encourrai toujours la responsabilité des fautes d'Antoine, parce que je paraîtrai l'avoir mis à même de les commettre. Que s'il peut être question d'une paix avec le brigandage d'Antoine, le choix qu'on a fait de moi pour en être le médiateur est ce qui convenait le moins. C'est moi qui jamais n'ai été d'avis d'envoyer des députés ; c'est moi qui, avant le retour des députés, ai osé dire que, dans le cas même où ils apporteraient la paix, comme ce mot cacherait la guerre, il faudrait la repousser; c'est moi qui, le premier, ai proposé de prendre l'habit de guerre ; moi qui ai toujours appelé Antoine ennemi, quand d'autres ne voyaient en lui qu'un adversaire politique; moi qui ai toujours appelé guerre ce que d'autres nommaient tumulte. Et tous ces discours, je ne les ai pas tenus dans le sénat seulement, je les ai toujours répétés devant le peuple; non seulement encore contre Antoine lui-même, mais contre les complices et les agents de ses forfaits, tant ceux qui sont à Rome que ceux qui sont avec lui; enfin, c'est contre toute la maison de M. Antoine que je me suis toujours répandu en invectives. Aussi, joyeux et triomphants de l'espoir de la paix, les mauvais citoyens, tout en s'en félicitant comme d'une victoire, repoussaient-ils en moi un ennemi objet de toutes leurs plaintes. Ils se défiaient aussi de Servilius; ils se ressouvenaient qu'Antoine avait été frappé par les votes de ce consulaire. Dans L. César, ils voyaient un sénateur ferme et courageux, mais cependant l'oncle d'Antoine; dans Calenus, l'agent de ses intérêts; dans Pison, son ami ; dans vous-même, Pansa, un consul énergique et intrépide, mais que déjà ils croient radouci : non qu'il en soit ou qu'il puisse en être quelque chose; mais, comme vous avez parlé de paix, bien des gens ont soupçonné vos intentions de n'être plus les mêmes. C'est avec peine que les amis d'Antoine me voient mêlé parmi tous ces personnages que je viens de nommer : il faut leur donner satisfaction, puisque déjà nous avons commencé à nous montrer si généreux. VIII. Qu'ils partent donc, nos députés, sous les meilleurs auspices; mais que ceux-là seuls partent dont la vue ne blesserait point Antoine. Que si vous vous souciez peu d'Antoine, vous devez peut-être, Pères conscrits, me porter quelque intérêt. Épargnez au moins à mes yeux un spectacle trop pénible, et accordez quelque indulgence à mon juste ressentiment. En effet, de quel oeil pourrais-je voir, je ne dis pas l'ennemi de la patrie (à ce titre, ma haine se confond avec la vôtre) ; mais comment envisagerais-je celui qui, pour moi personnellement, est le plus cruel ennemi, si l'on en juge par ses sanglantes harangues contre moi? Me croyez-vous donc un coeur de fer, pour être capable d'aborder, d'envisager celui qui, récemment, dans une assemblée convoquée pour assurer des gratifications à ceux de ses parricides satellites dont il avait distingué l'audace, annonça qu'il faisait don de mes biens à un Petissius d'Urbinum, qui, dans le naufrage de son riche patrimoine, s'est jeté, comme sur une vigie de refuge, dans le parti d'Antoine? Pourrai-je envisager L. Antonius, à la cruauté duquel je n'aurais pu échapper, si les murs, et les portes, et le dévouement de mon municipe ne m'eussent protégé? Et ce même mirmillon d'Asie, ce brigand d'Italie, ce collègue de Lenton et de Nucula, comme il donnait au centurion Aquila des écus d'or, n'a-t-il pas dit qu'il les lui donnait de mon bien? S'il eût dit de son bien, l'oiseau même qui porte le nom d'Aquila n'en aurait rien pu croire. Jamais, non, jamais mes yeux ne pourront supporter ni Saxa ni Caphon, ni les deux préteurs, ni le tribun du peuple, ni les deux tribuns désignés, ni Bestia, ni Trebellius, ni Plancus. Je ne puis sans répugnance voir tant d'ennemis si malfaisants, si criminels; et c'est moins l'effet de mon mépris pour eux que de mon amour pour la patrie. Mais je triompherai de mon indignation, je saurai me contraindre; et le plus juste ressentiment, si je ne puis le surmonter, je parviendrai du moins à le dissimuler. Eh quoi ! Pères conscrits, croyez-vous que c'est de la vie que je doive ici faire quelque estime? Elle ne m'est rien moins que précieuse, surtout depuis que Dolabella s'est conduit de manière à me rendre la mort désirable, pourvu qu'elle fût exempte de supplices et de tortures. Pour vous cependant, et pour le peuple romain, mon existence ne doit pas être tout à fait à dédaigner. Je suis en effet, si je ne m'abuse, grâce à mes veilles, à mes soins, aux opinions que j'ai émises, aux périls sans nombre que j'ai affrontés en présence de la haine de tous les scélérats conjurés contre moi, je suis parvenu, pour ne point parler de moi avec trop de présomption, à ne pas nuire à la république. Et s'il en est ainsi, pensez-vous que je ne doive pas songer un peu à mes dangers personnels? IX. Ici, alors même que j'étais au sein de Rome et de mes foyers, maintes tentatives ont été faites contre mes jours, bien que non seulement le dévouement de mes amis, mais les regards de toute la ville veillent à ma conservation. Pensez-vous que, lorsque je me serai mis en route, surtout pour un long voyage, nulles embûches ne seront à redouter pour moi? Trois chemins conduisent à Modène, où déjà mon coeur se hâte d'arriver pour pouvoir au plus tôt contempler la première colonne de la liberté romaine, D. Brutus, dans les embrassements duquel je serais heureux d'exhaler mon dernier soupir, si tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit pendant ces derniers mois, avait atteint le but que je m'étais proposé. Il y a, dis-je, trois routes du côté de la mer Supérieure, la voie Flaminienne; le long de la mer Inférieure, la voie Aurélienne ; au milieu, la voie Cassia. Or, je vous prie, examinez si mes craintes personnelles ne reposent que sur de vaines conjectures. La voie Cassia traverse l'Étrurie. Ignorons-nous, Pansa, en quels lieux Lenton Césennius exerce son autorité septemvirale? Avec nous, certes, il n'est ni de corps ni d'âme. S'il est dans sa maison ou près de chez lui, il est toujours en Étrurie, c'est-à-dire sur mon chemin. Et qui me répondra que Lenton se contente d'une seule tête? Dites-moi encore, Pansa, où est Ventidius, dont j'ai toujours été l'ami avant qu'il fût devenu pour la république et pour tous les gens de bien un ennemi déclaré. Je puis éviter la voie Cassia et suivre la voie Flaminienne; mais si c'est à Ancône que Ventidius se trouve, comme on le dit, pourrai-je en sûreté m'approcher d'Ariminum? Reste la voie Aurélienne : là du moins je trouverai protection ; là, en effet, sont les terres de P. Clodius : toute sa maison viendra au-devant de moi, et m'offrira l'hospitalité en considération de notre amitié bien connue. X. Me confierai-je à ces chemins, moi qui récemment, aux fêtes Terminales, voulant aller à la campagne avec l'intention de revenir le même jour, ne l'ai point osé? Dans les murs de ma maison, je serais à peine en sûreté sous la garde de mes amis: c'est pourquoi je reste à Rome; et si l'on me le permet, j'y resterai. Ici est mon domicile, ici ma vigie, ici mon poste, ici mon campement à demeure. Que d'autres occupent les camps, les royaumes, les armées ; qu'ils poursuivent l'ennemi : nous, comme nous l'avons toujours dit, comme nous l'avons toujours fait, nous protégerons de concert avec vous Rome et la sûreté de Rome. Je ne refuse pourtant pas la députation, quoique je voie le peuple romain la refuser pour moi. Nul n'est moins timide que moi, mais nul n'est plus circonspect : les faits le prouvent. Depuis vingt ans, c'est moi seul que les scélérats attaquent : leur châtiment m'a bien vengé; ou, sinon moi, du moins la république. Jusqu'ici la république m'a conservé pour elle. Je tremble de le dire, sachant combien la vie humaine est semée d'accidents; cependant, assiégé une fois par les forces réunies, par l'élite des hommes les plus puissants, j'ai succombé volontairement, afin de pouvoir honorablement me relever. Ne m'accusera-t-on pas de témérité, d'imprévoyance, si je me fie à cette route si infestée, si dangereuse? Mourir avec gloire est aussi le devoir de ceux qui dirigent les affaires publiques; ils ne doivent pas laisser après eux le reproche d'une faute, le blâme d'une folle imprudence. Quel homme de bien ne déplore la mort de Trebonius? qui ne gémit sur le trépas d'un tel homme, d'un tel citoyen ? Il est pourtant des gens qui disent, bien sévèrement sans doute, mais ils le disent toutefois, que ce qui rend Trebonius moins à plaindre, c'est qu'il n'a pas su se mettre en garde contre un infâme scélérat; car celui qui se constitue le gardien de beaucoup d'autres doit, selon la maxime des sages, commencer par se garder lui-même. Lorsqu'on est environné des lois et de la terreur salutaire des tribunaux, doit-on voir partout des périls, se précautionner contre tous les piéges? Qui oserait, en effet, en plein jour, sur une grande route, attaquer un homme bien escorté, un citoyen illustre? Mais ces raisons ne conviennent ni au temps présent ni à ma position personnelle. Loin de craindre le châtiment, celui qui m'attaquera pourra se flatter d'obtenir et gloire et récompenses de la part de tout ce ramas de brigands. XI. Voilà ce que dans Rome je puis prévoir ; il m'est facile, en portant mes regards autour de moi, de voir d'où je sors, où je vais, ce qui est à droite, et ce qui est à gauche. Pourrai-je, dans les défilés de l'Apennin, en faire autant? Là, quand même des embûches ne me seraient pas dressées, comme il est si facile de le faire, mon anxiété d'esprit sera telle, que je ne pourrai donner aucune attention aux devoirs de la mission dont je serai chargé. Mais, soit; j'ai évité les piéges, j'ai franchi l'Apennin, maintenant il faut me présenter à Antoine et entrer avec lui en conférence. Quel lieu choisira-t-on? Si c'est hors des deux camps, que les autres députés en pensent ce qu'ils voudront; pour moi, j'y vois une mort prompte et certaine. Je connais la fureur de l'homme, je connais sa violence effrénée; la dureté de son caractère, son naturel farouche n'est pas même adouci par le vin dont il s'abreuve habituellement. Enflammé de colère et de démence, assisté de Lucius, cet être exécrable, il ne s'abstiendra certes jamais de porter sur moi ses mains sacrilèges et impies. Ma mémoire me rappelle quelques entrevues d'ennemis acharnés, de citoyens violemment divisés. Le consul Cn. Pompée, fils de Sextus, eut en ma présence, lorsque je faisais sous lui mes premières armes, une conférence, à la vue des deux camps, avec P. Vettius Scaton, général des Marses. Je me souviens qu'alors Sext. Pompée, frère du consul, vint exprès de Rome pour cette entrevue : c'était un homme instruit et plein de sagesse. Scaton le salua en prononçant ces mots : "Quel nom vous donnerai-je?" — "Votre hôte par inclination", répondit Pompée ; "votre ennemi par nécessité." On vit présider à cette entrevue la justice : aucune crainte, aucun soupçon ne s'y glissa; il y avait de la modération jusque dans la haine. Et, en effet, les alliés, loin de chercher à nous ôter le droit de cité, ne voulaient qu'y participer. Sylla et Scipion, dans une conférence entre Calés et Téanum, où l'un avait à sa suite la fleur de la noblesse, et l'autre les alliés de la république, eurent des conditions et des conventions réciproques à stipuler entre eux, relativement à l'autorité du sénat, aux suffrages du peuple et au droit de cité. Dans cette entrevue, la bonne foi ne fut pas entière; mais tout se passa du moins sans violence et sans danger. Pouvons-nous donc, exposés au brigandage d'Antoine, être également en sûreté? Nous ne le pouvons pas; ou, si d'autres l'espèrent, moi, je ne puis m'en flatter. XII. Si ce n'est point hors des deux camps que doit avoir lieu la conférence, quel camp choisirons-nous? Dans le nôtre, il ne viendra jamais ; beaucoup moins nous dans le sien. Reste à recevoir et à remettre de part et d'autre les propositions par écrit : nous demeurerons ainsi chacun dans notre camp. Sur toutes ces demandes, je n'aurai qu'un avis ; quand je vous l'aurai dit ici, supposez que j'ai fait le voyage et que je suis de retour : mon ambassade sera terminée. Mon seul avis sera de renvoyer tout au sénat, quelque demande que puisse faire Antoine. Toute autre conduite serait illégale, car nous n'avons point reçu de cet ordre les pouvoirs qu'à la suite d'une guerre on défère ordinairement à dix commissaires, suivant les anciens usages; enfin le sénat ne nous a donné absolument aucune instruction. Tandis que je parlerai ainsi dans la réunion de mes collègues, non sans trouver probablement quelque opposition, n'est-il pas à craindre qu'une aveugle soldatesque ne voie en moi un obstacle à la paix? Supposez que les légions nouvelles ne désapprouvent point ma résolution : car, pour la légion de Mars et la quatrième, vous pouvez être persuadés qu'elles n'approuveront rien que de conforme à l'honneur et à la gloire ; je le sais positivement. Fort bien ; et les vétérans, ne devons-nous pas avoir pour eux des ménagements? car pour de la crainte, eux-mêmes ne veulent pas l'inspirer. Mais cependant, comment prendront-ils mon rigorisme ? On leur a débité sur mon compte beaucoup de faussetés; des méchants leur ont fait beaucoup de rapports perfides. Les intérêts des vétérans, c'est vous surtout que j'en atteste, ont toujours été protégés par mes votes, par mon influence, par mes discours ; mais ils en croient des méchants, ils en croient leurs prétendus amis. Ils sont braves sans doute, mais le souvenir de ce qu'ils ont fait pour la liberté, pour le salut public, les rend trop fiers et les fait en appeler à la force de toutes nos délibérations. Ce n'est point leur réflexion que je crains, c'est leur premier élan que je redoute. Si j'échappe encore à tous ces périls si menaçants, croyez-vous mon retour suffisamment assuré? Lorsque, grâce à votre autorité, et comme j'ai coutume de le faire, j'aurai su me défendre, et que j'aurai fait preuve de dévouement et de courage pour la cause de la république, ce ne seront plus seulement mes ennemis, mais encore les envieux qu'il me faudra redouter. Protégez donc ma vie pour la république; et autant que l'honneur et la nature le permettront, réservons-la pour la patrie ; que ma mort ne soit amenée que par l'arrêt inévitable du destin : ou s'il me faut aller au-devant de la mort, que du moins ce soit avec gloire. Dans cet état de choses, quoique cette députation, pour ne rien dire de plus, ne soit nullement conforme au voeu de la république, cependant, si je puis le faire en sûreté, je partirai. En tous points, Pères conscrits, ma conduite dans cette affaire sera réglée uniquement, non sur mes dangers personnels, mais sur l'utilité publique. Toutefois, puisqu'on m'en laisse le temps, je crois devoir tout peser mûrement, et ne me déterminer que pour le parti que j'aurai jugé le plus avantageux à l'intérêt de la république. |