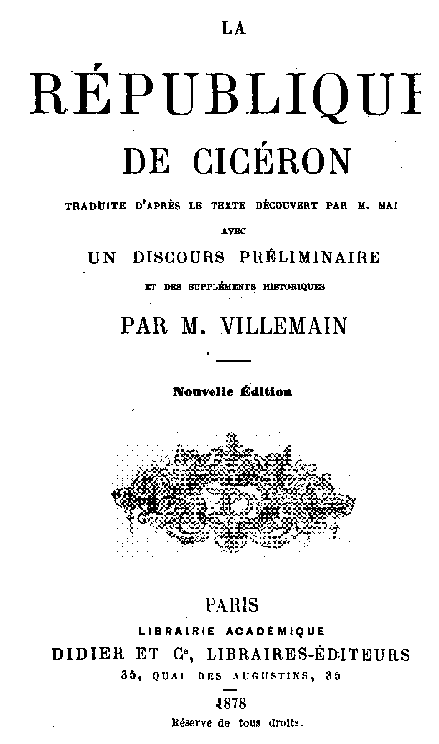|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
CICÉRON
*******************
DE LA RÉPUBLIQUE.
*******************
LIVRE SECOND.
**********************
I. Dès[1] qu'il vit tout le monde impatient de l'entendre, Scipion prit la parole en ces termes : Je commencerai par une pensée du vieux Caton, que, vous le savez, j'ai singulièrement aimé, j'ai beaucoup admiré, et à qui, soit par l'influence éclairée de mes parents adoptifs et naturels, soit de mon propre mouvement, je m'étais donné tout entier dès la jeunesse, sans pouvoir jamais me rassasier de ses sages discours ; tant je trouvais en lui une rare expérience de la chose publique, qu'il avait gouvernée dans la paix et dans la guerre, et si bien et si longtemps ; une juste mesure dans toutes ses paroles, un enjouement mêlé de gravité, un goût merveilleux de s'instruire et de communiquer l'instruction, et une vie tout entière en accord avec ses discours! Il disait donc souvent, que si le gouvernement de Rome l'emportait sur celui des autres cités, c'est qu'elles n'avaient presque jamais eu que des grands hommes isolés qui avaient constitué chacun sa patrie, d'après ses lois et ses principes particuliers, Minos, la Crète, Lycurgue, Lacédémone; et dans Athènes, qui subît tant de mutations, d'abord Thésée, puis Dracon, puis Solon, puis Clisthène, puis tant d'autres, et enfin, pour ranimer son épuisement et sa faiblesse, un savant homme, Démétrius de Phalére; tandis que nous, notre constitution politique a été l'œuvre du génie, non d'un seul, mais de plusieurs,[2] et s'est affermie, non par un seul âge d'homme, mais durant plusieurs générations et plusieurs siècles. Car, ajoutait-il, il n'a jamais existé un génie assez puissant pour que rien ne lui échappât ; et tous les génies du monde, réunis en un seul, ne pourraient pas, dans les limites d'une seule époque, exercer une prévoyance assez étendue pour tout embrasser, sans le secours de l'expérience et de la durée. Ainsi, suivant la manière habituelle de Caton, je remonterai, dans mon discours, à l'origine de Rome ; car, j'aime à me servir de l'expression même de Caton. J'atteindrai d'ailleurs plus facilement mon but, en prenant notre république, pour la montrer successivement à sa naissance, dans ses progrès, dans son âge adulte, et dans sa force et sa maturité, que si j'allais, à l'exemple de Socrate dans les livres de Platon, me créer une république imaginaire. II. Tout le monde paraissant approuver, Scipion reprit : Quel commencement d'une constitution politique puisse choisir qui soit aussi éclatant, aussi connu de tous que la fondation même de cette ville, par la main de Romulus, fils de Mars? Ayons en effet cette déférence pour une tradition tout à la fois antique et sagement accréditée par nos ancêtres, de souffrir que ceux qui ont bien mérité des hommes réunis, aient la réputation d'avoir reçu des dieux, non seulement le génie, mais la naissance même. On rapporte donc que, sitôt après la naissance de Romulus et de son frère Rémus, Amulius, roi d'Albe, dans la crainte de voir un jour ébranler sa puissance, le fit exposer sur les bords du Tibre; que, dans ce lieu, l'enfant secouru et allaité par une bête sauvage,[3] ensuite recueilli par des bergers, et nourri dans la rudesse et les travaux des champs, prit, en grandissant, une telle supériorité sur les autres par la vigueur de corps et la fierté de courage, que tous les habitants de ces campagnes, où s'élève aujourd'hui Rome, se soumirent volontairement à lui. S'étant mis à la tête de ces bandes, on dit encore, pour en venir des fables aux réalités, qu'il surprit Albe, ville forte et puissante à cette époque, et qu'il mit à mort Amulius. III. Cette gloire acquise, il conçut alors, dit-on, la première pensée de fonder régulièrement une ville et de constituer un État. Sous le rapport du lieu, et ce point doit être la principale prévoyance de quiconque veut jeter le germe d'une cité durable, Romulus choisit la situation de sa ville avec une merveilleuse convenance. En effet, il ne la rapprocha point de la mer, ce qui lui était si facile avec les forces, dont il disposait, soit en avançant sur le territoire des Rutules et des Aborigènes, soit en venant bâtir sa nouvelle cité à l'embouchure du Tibre, dans le lieu même où, longues années après, Ancus Martius conduisit une colonie. Mais cet homme, avec la prévoyance d'un génie supérieur, comprit et observa que les sites voisins de la mer n'étaient pas les plus favorables, pour y fonder des villes qui prétendissent à la durée et à l'empire : et cela, d'abord parce que les villes maritimes seraient toujours exposées, non seulement à de fréquents périls, mais à des périls imprévus. La terre ferme, en effet, trahit par de nombreux indices les approches régulières, et même les surprises de l'ennemi; elle le dénonce, pour ainsi dire, par le bruit seul et comme par le retentissement de ses pas. Il n'est point d'agresseur qui, sur le continent, puisse arriver si vite que nous ne sachions qu'il vient, et ce qu'il est, et d'où il vient. Mais cet ennemi, que la mer et qu'une flotte nous amène, peut descendre sur nos bords avant que personne ait soupçonné son approche ; et lorsqu'il arrive, rien d'extérieur n'indique ni ce qu'il est, ni de quelle terre il est parti, ni ce qu'il veut; on ne peut enfin reconnaître et distinguer à aucun signe, s'il est ami, ou ennemi. IV. Les villes maritimes éprouvent encore une influence corruptrice et de fréquentes révolutions de mœurs. Leur civilisation est en effet mélangée de langues et de notions nouvelles; et le commerce leur apporte de loin, non seulement des marchandises, mais des mœurs étrangères, qui ne laissent rien de stable dans les Institutions de ces villes, et d'abord, les peuples qui les habitent ne s'attachent pas à leurs foyers ; mais une continuelle mobilité d'espérances et de pensées les emporte loin de la patrie ; et lors même qu'ils ne changent pas réellement de place, leur esprit toujours aventureux, voyage et court le monde : nulle autre cause, après avoir miné longtemps et Corinthe et Carthage, ne concourut plus à les détruire que cette vie errante et cette dispersion des citoyens, a qui la passion du commerce et des entreprises maritimes avait fait abandonner le soin des champs et de la guerre.[4] Le voisinage de la mer, d'ailleurs, fournit au luxe des villes un grand nombre de séductions funestes, qui sont importées par la victoire ou par les échanges. L'agrément même d'un tel site présente aux passions une foule d'attraits pour le luxe et pour la paresse. Ce que j'ai dit de Corinthe, je ne sais si je ne pourrais pas l'appliquer, avec la même exactitude, à toute la Grèce; car, le Péloponnèse même est dans la mer presque de toutes parts:[5] et si vous exceptez tes Phliasiens, il n'est aucun de ces peuples, dont le territoire ne confine à la mer ; et, hors du Péloponnèse, les Énianes, les Dorions et les Dolopes sont seuls éloignés de la mer. Que dirai-je des îles de la Grèce, qui, au milieu de cette ceinture de flots, semblent nager encore avec les institutions et les mœurs de leurs mobiles cités? et ceci, comme je l'ai dit plus haut, ne regarde que l'ancienne Grèce. Mais, quant aux colonies conduites par les Grecs dans l'Asie, la Thrace, la Sicile, l'Italie, l'Afrique, il n'est aucun de ces établissements, excepté la seule Magnésie, qui ne soit baigne par les flots. Il semblerait qu'une portion détachée des rivages de la Grèce est venue border ces continents barbares. Parmi les barbares, en effet, il n'y avait originairement aucun peuple maritime, à l'exception des Carthaginois et des Étrusques, qui cherchaient les uns le commerce, les autres le pillage. On voit donc la cause manifeste des malheurs et des révolutions de la Grèce : elle tient à ces vices des cités maritimes, que j'ai rapidement indiqués plus haut; mais, à ces vices se trouve joint un grand avantage : c'est que, des divers points du monde, tout vienne facilement aborder à la ville que vous habitez, et que l'on puisse, en retour, porter et envoyer dans tous les lieux de la terre les produits des champs qui environnent vos murs. V. Romulus[6] pouvait-il donc, et pour réunir tous les avantages d'une situation maritime, et pour en éviter les dangers, être mieux inspiré qu'il ne le fut, en bâtissant Rome sur la rive d'un fleuve, dont le cours égal et constant se décharge dans la mer par une vaste embouchure, de sorte que cette ville peut recevoir par mer tout ce qui lui manque, et renvoyer, par Le même chemin, sa surabondance, et qu'elle trouve dans le même fleuve une communication, non seulement pour faire venir par la mer tous les produits nécessaires au soutien et à l'élégance de la vie, mais pour les tirer de ses propres campagnes : aussi, je croirais que Romulus avait pressenti dès lors que cette cité serait Un jour le siège et le centre d'un puissant empire. Car, placée sur tout autre point de l'Italie, jamais ville n'aurait pu maintenir une si vaste domination. VI. Quant aux fortifications naturelles de Rome, quel homme est assez indifférent pour ne pas en avoir dans l'esprit l'exacte connaissance et comme le dessin? Tels furent d'abord le plan et la direction des murs, qui, par la sagesse de Romulus et de ses successeurs, confinaient de toutes parts à de hautes et rudes collines, que le seul passage ouvert, entre le mont Esquilin et le mont Quirinal, se trouvait fermé par un rempart et un immense fossé, et que la citadelle s'appuyait sur un rocher coupé à pic, et d'un abord assez impraticable, pour avoir pu, même dans cet horrible débordement de l'invasion gauloise, se conserver libre et hors d'atteinte. Romulus choisit d'ailleurs un lieu rempli de sources vives, et remarquable par la salubrité, au milieu d'une région pestilentielle. Là, s'élèvent en effet des collines ventilées du souffle de l'air, et qui protègent la vallée de leur ombre. VII. L'œuvre fut rapidement achevé : car, il bâtit une ville à laquelle il donna le nom de Rome, emprunté du sien; et, pour affermir cette nouvelle cité, il conçut un projet singulier sans doute, et même un peu barbare, mais digne d'un grand homme, et d'un esprit qui voyait loin dans l'avenir comment fortifier sa puissance et son peuple. De jeunes filles sabines, de la meilleure naissance, venues à Rome, pour les jeux publics, dont Romulus faisait alors célébrer dans le Cirque le premier anniversaire, furent, au milieu de la fête, enlevées par ses ordres, et unies par des mariages, aux premières familles de Rome. Ce grief ayant appelé sur Rome les armes des Sabins, au milieu d'un combat, dont l'issue était indécise et disputée, Romulus traite avec Tatius, roi des Sabins, à la prière des femmes que les Romains avaient enlevées. Par cette alliance; il admit les Sabins dans la nouvelle cité, reçut le culte de leurs dieux, et partagea sa puissance avec leur roi. VIII. Après la mort de Tatius, l'autorité tout entière retomba dans ses mains : il avait à la vérité, d'accord avec Tatius, choisi pour conseil du Roi les principaux citoyens, auxquels l'affection publique donna le titre de Pères. Il avait partagé le peuple en trois tribus, appelées du nom de Tatius, du sien, et de celui de Lucumon mort, à ses côtés, dans le combat contre les Sabins ; et il avait fait une autre division en trente curies, désignées par les noms de celles des jeunes Sabines qui étaient devenues les heureuses médiatrices de l'alliance et de la paix. Mais, quoique l'établissement de cet ordre eût commencé, pendant la vie de Tatius, après lui, cependant, Romulus régna plus que jamais par l'ascendant et la sagesse du sénat. IX. En cela, Romulus comprit et adopta ce même principe, que Lycurgue à Lacédémone avait aperçu, peu de temps, avant lui ; c'est que l'unité d'empire et la puissance royale valent mieux pour gouverner et régir les Etats, si l'on peut joindre à cette force de gouvernement l'influence morale des meilleurs citoyens. Ainsi, fort et comme appuyé de ce conseil, de ce sénat, il fît, avec succès, plusieurs guerres aux peuples voisins; et, sans rapporter dans sa propre maison aucune part du butin, il ne se lassa pas d'enrichir les citoyens. Romulus eut aussi grand égard à cette institution des auspices, qu'aujourd'hui nous maintenons encore, au grand profit du salut public : car, d'abord, il les consulta lui-même pour la fondation de Rome, ce qui fut la première base de la république ; et, dans la création de tous les établissements publics, il eut soin également de prendre les auspices, en s'associant à lui-même, dans cette cérémonie, un augure tiré de chacune des tribus. Il mit aussi le peuple sous la clientèle des grands, mesure dont j'examinerai dans la suite tous les avantages. Les punitions étaient des amendes qui se payaient en bœufs et en moutons ; car toute la fortune consistait alors en troupeaux et en terres, ce qui même a déterminé le choix des expressions par lesquelles, en latin, on désigne les riches. Romulus n'employait point d'ailleurs la rigueur et les supplices. X. Après qu'il eut régné trente-sept ans, et fondé ces deux illustres appuis de la république, les auspices et le sénat, étant disparu dans une soudaine éclipse de soleil, il obtint cette gloire qu'on le crut transporté parmi les dieux, renommée que nul mortel n'a jamais pu mériter, sans l'éclat d'une vertu extraordinaire; et cette apothéose est d'autant plus admirable dans Romulus, que les autres hommes divinisés le furent à des époques peu éclairées, où la fiction était plus facile, l'ignorance poussant à la crédulité. Mais, nous voyons que Romulus vivait, il y a moins de six cents ans, dans un temps où les sciences et les lumières étaient déjà fort anciennes, et où on avait dépouillé ces antiques erreurs d'une société inculte et grossière. En effet, si, comme on l'établit par les annales des Grecs, Rome fut fondée dans la seconde année de la septième olympiade, l'existence de Romulus se rapporte au temps que la Grèce était déjà remplie de poètes et de musiciens, siècle où des fables contemporaines n'auraient obtenu que bien peu de croyance. En effet, ce fut cent huit ans, après la promulgation des lois de Lycurgue, que s'établit la première olympiade; bien que, par une méprise de nom, quelques auteurs en aient rapporté l'institution à Lycurgue lui-même. D'autre part, les calculs les plus modérés placent Homère trente ans, au moins, avant Lycurgue. On peut en conclure aisément, qu'Homère précéda de beaucoup d'années le temps de Romulus. Ainsi l'instruction des hommes et les lumières même du siècle devaient laisser alors peu de place au succès d'une fiction. L'antiquité, en effet, a pu recevoir des fables, quelquefois même assez grossières; mais cette époque, déjà cultivée, était prête à repousser par la dérision toute supposition invraisemblable. …………………………. …………………………………………………………………………………………………………… Nouvelle preuve que l'on crut à l'apothéose de Romulus, au milieu d'une civilisation déjà perfectionnée par le temps, l'expérience et la réflexion. Sans doute il y avait en lui une grande puissance de vertu et de génie, pour que, sur la foi d'un homme simple, oh admit, à l'honneur de Romulus ce que, depuis plusieurs siècles, les hommes n'avaient voulu croire en faveur d'aucun autre mortel. On écouta Proculus,[7] lorsque, par l'inspiration des sénateurs, qui voulaient écarter loin d'eux le soupçon de la mort de Romulus, il affirma devant le peuple qu'il avait vu Romulus sur la colline appelée maintenant Quirinal, et qu'il en avait reçu l'ordre d'inviter le peuple à bâtir sur cette colline un temple à ce Dieu nouveau, qui s'appelait Quirinus. XI. Ne voyez-vous donc pas que le génie de cet homme ne se borna point à donner naissance à un peuple nouveau, pour le laisser ensuite dans les langes du premier âge, mais qu'il dirigea son développement et sa jeunesse ? Lælius répondit : Nous voyons aussi que vous avez pris une méthode nouvelle de discussion, qui ne se retrouve nulle part dans les livres des Grecs. Car, ce premier maître que personne n'a surpassé pour l'éloquence, Platon, s'était donné lui-même un libre territoire, pour y bâtir une ville, au gré de son génie, ville admirablement imaginée peut-être, mais étrangère aux mœurs communes et à la vie réelle des hommes. Les antres, sans se proposer aucun modèle, aucun type particulier de république, ont disserté sur les formes et les Constitutions des états. Vous me paraissez, au contraire, réunir les deux méthodes : car, dans la marche que vous avez prise, vous aimez mieux attribuer à d'autres vos découvertes, que d'imaginer, en votre propre nom, comme le fait Socrate, dans Platon ; et, en parlant du site de Rome, vous ramenez à un système ce qui, dans Romulus, fut le résultat du hasard, ou de la nécessité; et vous ne laissez pas errer votre discours sur mille exemples divers ; mais vous le concentrez sur une seule république. Suivez donc la route que vous avez choisie : je crois déjà entrevoir que vous allez examiner successivement les autres règnes, comme offrant une forme de gouvernement entière et complète. XII. Ce sénat de Romulus, continua Scipion, qui se composait des grands que le Roi avait assez favorisés, pour vouloir qu'ils fussent nommés pères, et leurs enfants patriciens, tenta, après la mort de Romulus, de gouverner sans roi la république : mais le peuple ne le souffrit pas; et, dans le regret de la perte de Romulus, il ne cessa de réclamer un roi. Les grands, alors, imaginèrent prudemment une forme d'interrègne[8] nouvelle et inconnue des autres nations ; de sorte qu'en attendant la nomination définitive d'un roi, l'État ne fût ni sans roi, ni soumis trop longtemps au même roi, ni exposé à voir quelqu'un, par l'exercice prolongé du pouvoir, contracter de la répugnance à le déposer, ou prendre des forces pour le retenir. Ce peuple nouveau comprit donc une chose ignorée du Lacédémonien Lycurgue, qui n'avait pas jugé que le roi dût être électif, si toutefois la question dépendit de Lycurgue, mais avait préféré de garder pour souverain le descendant,[9] quel qu'il fût, de la race d'Hercule. Nos Romains, tout rudes et tout grossiers qu'ils étaient alors, sentirent qu'il fallait chercher non pas une descendance royale, mais une sagesse et une vertu dignes du trône. XIII. La renommée reconnaissant ces qualités éminentes dans Numa Pompilius, le peuple romain, sans tenir compte de ses propres citoyens, se donna lui-même, par le conseil des sénateurs, un roi d'origine étrangère ; et il appela de la ville de Cures à Rome, ce Sabin, pour régner sur lui. Numa, quoique le peuple l'eût nommé roi, dans des Comices par Curies, proposa lui-même, touchant la forme de son pouvoir, une loi qui fut également votée par les Curies ; et voyant que; les institutions de Romulus avaient passionné les Romains pour la guerre, il jugea qu'il fallait affaiblir en eux cette première habitude. XIV. Et d'abord, il divisa par tête, entre les citoyens, les terres que Romulus avait conquises ; il leur fît comprendre que, sans le secours du pillage et de la guerre, ils pouvaient, par la culture des champs, se procurer tous les avantages ; et il leur inspira l'amour du repos et de la paix, le meilleur abri pour faire prospérer aisément la justice et la bonne foi, et la protection la plus puissante pour garantir les travaux des champs et la sûreté des moissons. Pompilius ayant créé des auspices d'un ordre supérieur, ajouta deux augures à l'ancien nombre. Il confia la présidence des sacrifices à cinq pontifes, choisis parmi les principaux citoyens; et par des lois que nous conservons dans nos Archives, il calma les âmes enflammées par l'usage et l'ardeur des combats, et les retint au milieu des tranquilles cérémonies de la religion. Il établit encore les flamines, les saliens, les vierges vestales ; et il régla saintement toutes les parties du culte public. Dans l'ordonnance des sacrifices, il voulut que la cérémonie fût très compliquée, et l'offrande très simple. En effet, il fixa beaucoup de formes qu'il était nécessaire de connaître et d'observer, mais qui n'exigeaient aucun frais dispendieux. Ainsi, dans la pratique du culte, il rendit la piété plus attentive et moins coûteuse. Ce fut aussi Numa qui mit le premier en usage les marchés, les jeux, et toutes les occasions de rapprocher et d'assembler les hommes. Par ces établissements, il ramena vers la douceur et la bienveillance des esprits, que la passion des armes avait rendus violents et farouches. Ayant ainsi régné, au milieu de la paix et de l'union la plus profonde, pendant trente-neuf ans (car nous devons suivre ici, de préférence, notre Polybe, que personne n'a surpassé pour le soin de vérifier les temps et les dates), il quitta la vie,[10] après avoir affermi les deux gages les plus puissants de la durée de la République, la religion et la clémence. XV. Quand Scipion eut achevé ces mots : Est-elle vraie, dit Manilius, la tradition qui suppose que ce roi Numa avait été l'élève de Pythagore lui-même, ou du moins qu'il fut pythagoricien? Je l'ai souvent ouï dire à des vieillards, et nous savons que c'est l'opinion vulgaire ; mais cela n'est pas clairement indiqué par le témoignage des annales publiques. Fausseté de tout point, reprit l'Africain; supposition non seulement fausse, mais ignorante et absurde, dans sa fausseté. Car il ne faut jamais tolérer ces suppositions de faits qui non seulement n'ont pas eu lieu, mais qui, nous le voyons, étaient impossibles. Ce fut, en effet, la quatrième année du règne de Tarquin le Superbe, que Pythagore vint à Sybaris, à Crotone, et dans cette portion de l'Italie. La soixante-douzième olympiade est la date commune de l'élévation de Tarquin au trône, et du voyage de Pythagore, d'où l’on peut conclure, en calculant la durée des règnes, que cent quarante ans s'étaient écoulés, depuis la mort de Numa, quand Pythagore toucha pour la première fois l'Italie, et ce fait, dans l'esprit des hommes qui ont soigneusement étudie les annales des temps, n'a jamais rencontré le plus léger doute. Grands dieux ! dit Manilius, que l’erreur contraire est générale et invétérée! Du reste, je me résigne aisément à croire que notre éducation ne nous est pas venue d'outre-mer et par des connaissances importées, mais qu'elle est due tout entière à des vertus indigènes et domestiques. XVI. Vous le verrez beaucoup mieux encore, reprit l'Africain, si vous suivez la marche successive de notre République, et son progrès vers la perfection, par un chemin et comme par un mouvement naturel. Vous trouverez encore à louer la sagesse de nos aïeux, sur un autre point : beaucoup de choses qu'ils ont empruntées vous paraîtront devenues meilleures chez nous qu'elles ne l'étaient à la source, d'où on les a prises, et au lieu même de leur première origine; et vous comprendrez que le peuple romain s'est agrandi, non par le hasard,[11] mais par une prudence et une discipline, qu'à la vérité la fortune n'a pas contrariées. XVII. Après la mort de Numa, le peuple, sur la proposition d'un entre-roi, créa roi Tullus Hostilius, dans des Comices formés par curies; et Tullus, à l'exemple de Numa, fit délibérer sur son élévation à l'empire les Curies assemblées. Sa gloire éclata dans les armes ; et ses exploits militaires furent grands. Il construisit la place des Comices, et le palais du Sénat; et il les décora de dépouilles conquises. Il établit des formes légales, pour les déclarations de guerre ; et il consacra cet équitable usage par l'intervention religieuse des féciaux, de sorte que toute guerre qui n'était pas ainsi annoncée et déclarée, devait être regardée comme injuste et sacrilège. Et remarquez bien avec quelle sagesse nos rois comprirent dès lors ce qu'il fallait accorder au peuple ; car, nous avons beaucoup à dire sur ce point. Tullus ne se permit pas même de déployer les insignes de la royauté, sans l'ordre du peuple ; et pour avoir le droit de se faire précéder de douze licteurs, il crut avoir besoin de son aveu.[12] ....... XVIII. Manilius ou Lælius. Cette République, dont votre éloquence a tracé les fondements, ne se traîne pas vers la perfection ; elle y court à grands pas. Scipion. Après Tullus, un descendant de Numa par sa fille, Ancus Martius, fut établi roi par le peuple; et il eut aussi le soin de faire sanctionner son pouvoir par une loi Curiate.[13] Après avoir vaincu les Latins, il les admit au droit de cité dans Rome. Il joignit à la ville le mont Avenlin et le mont Cœlius. Il distribua les terres labourables, qu'il avait prises dans la guerre et il garda dans le domaine public les forêts, qu'il avait conquises, et qui étaient voisines de la mer. Il bâtit une ville à l'embouchure du Tibre, et la peupla d'une colonie. Après avoir ainsi régné vingt-trois ans, il mourut. Lælius dit alors : Ce roi mérite sans doute des éloges; mais l'histoire romaine est obscure, puisque nous savons le nom de la mère de ce roi; et que nous ignorons celui de son père. Scipion. Il est vrai : mais de toute cette époque, il n'y a guère que les noms des Rois qui soient entourés de quelque lumière. XIX. Pour la première fois alors, Rome parait s'être éclairée par l'influence d'une civilisation adoptive. Ce ne fut pas, en effet, un faible ruisseau détourné dans nos murs,[14] mais un fleuve immense qui nous apporta par torrents les sciences et les arts de la Grèce. Un Corinthien, est-il dit à ce sujet, Démarate, le premier homme de son pays par la considération, le crédit et la richesse, ne pouvant supporter le joug de Cypselus, tyran de Corinthe, avait fui avec de grands trésors, et était venu à Tarquinies, ville très florissante de l'Etrurie. Instruit bientôt que la domination de Cypselus ne faisait que s'affermir, en homme libre et courageux, il renonça pour jamais à sa patrie, se fit admettre au nombre des citoyens de Tarquinies, et fixa dans cette ville sa fortune et sa demeure. Ayant eu deux enfants de son union avec une femme de cette ville, il les instruisit dans toutes les sciences, sur le modèle de l'éducation grecque…………………………………………………. XX …………………………… L'un d'eux fut aisément reçu dans Rome; et par la politesse de ses mœurs et ses connaissances, il devint cher au roi Ancus, et passa pour être associé à tous ses projets, et partager presque avec lui le soin du royaume. Il avait, d'ailleurs, l'humeur la plus affable, et se montrait, à l'égard de tous les citoyens, prodigue de secours, de protection, de services, et même de largesses. Aussi Ancus mort, le peuple, par ses suffrages, choisit pour roi Lucius Tarquin, car, il avait ainsi transformé le nom grec de sa famille, afin de paraître imiter en tout les manières de ses concitoyens adoptifs. Dès qu'il eut fait ratifier son autorité par une loi, il s'occupa d'abord de doubler le nombre du sénat. Les anciens sénateurs, qu'il faisait opiner les premiers, furent appelés les pères des grandes familles; ceux qu'il avait ajoutés, les pères des familles de seconde création. Ensuite, il régla l'établissement de l’ordre équestre, sur le plan qui se conserve encore aujourd'hui. Il ne put, malgré tout son désir, changer les dénominations de Tatiens, Rhamnenses et Luceres, parce que Nævius,[15] augure très renommé, l'en dissuada. On trouve chez les Corinthiens l'usage d'assigner des chevaux pour le service public, et de les entretenir par une taxe sur les orphelins et les veuves. Mais, aux premières compagnies équestres Tarquin en ajouta de nouvelles, qui portèrent le corps des chevaliers à douze cents; et il doubla ce nombre, après avoir soumis les Èques, nation forte, guerrière, et menaçante pour Rome. Ayant aussi repoussé de nos murs les Sabins, il les poursuivit, les dispersa et les vainquit. Nous apprenons également que ce roi institua le premier les grands jeux appelés jeux romains que, dans la guerre contre les Sabins, au fort d'une bataille, il promit de consacrer, sur le Capitole, un temple à Jupiter très grand et très bon, et qu'il mourut, après un règne de trente-huit ans. XXI. Lælius dit alors : Tout justifie davantage le mot de Caton, que la constitution de la République ne fut l'œuvre ni d'un siècle, ni d'un homme; car on voit clairement quel progrès de choses bonnes et utiles fut amené par la succession de chaque règne. Mais nous sommes arrivés au roi qui me parait avoir eu, de tous, les plus grandes vues[16] pour l'État. Oui, dit Scipion, après Tarquin, en effet, on place Servius, qui le premier régna, sans un ordre du peuple. On le croit fils d'une femme esclave de Tarquinies, qui avait eu commerce avec un client du roi. Élevé parmi les domestiques du prince, et le servant à table, il fit remarquer le feu d'esprit qui déjà brillait en lui : tant il mettait de dextérité dans ses moindres actions, de grâce dans toutes ses paroles. Aussi, Tarquin qui n'avait que des fils au berceau, le prit en telle affection, que Servius passait généralement pour son fils; et il l'instruisit avec un spin extrême dans toutes les sciences qu'il possédait lui-même, et sur le plus complet modèle de l'éducation grecque. Tarquin périt par les embûches des fils d'Ancus ; et Servius, comme je l'ai dit, commença de régner, sans un ordre des citoyens, mais favorisé de leur bienveillance et de leur aveu. En effet, sur le bruit faussement répandu que Tarquin survivrait à sa blessure, Servius parut d'abord emprunter l'appareil royal, soulagea par ses bienfaits les débiteurs obérés, et montrant une grande affabilité, annonça qu'il rendrait la justice au nom de Tarquin. Ainsi, il évita de se confier au sénat. Enfin, après les funérailles de Tarquin, il consulta sur lui-même l'opinion du peuple ; et, autorisé à régner, il fit sanctionner son pouvoir par une loi rendue, dans les Curies assemblées. Il réprima d'abord par les armes les insultes des Étrusques ………………………………… XXII. ………. Il institua dix-huit centuries de chevaliers du premier degré; puis ensuite, ayant créé encore un nombre considérable de chevaliers, distinct de la masse populaire, il divisa le reste du peuple en cinq classes, sépara les plus âgés et les plus jeunes. Il régla cette distribution de manière à placer les suffrages dans la main, non de la multitude, mais des riches ; et il eut soin, chose importante à maintenir dans le gouvernement, que le plus grand nombre n'eût pas le plus de pouvoir.[17] Cette combinaison, si elle vous était moins connue, serait expliquée par moi ; mais, vous voyez tout le système : les centuries des chevaliers, augmentées de six nouvelles centuries, et la première classe, en y ajoutant une centurie de charpentiers, admis à cause de leur extrême utilité, formaient quatre-vingt-neuf centuries. Réunissez-y seulement huit centuries prises sur les cent quatre centuries restantes, vous avez la force entière du peuple romain : et la multitude bien plus nombreuse qui est répartie dans les quatre-vingt seize dernières centuries ne se trouvera ni éloignée du droit de suffrage, par une méprisante exclusion, ni en état d'exercer une dangereuse prépondérance. Servius, dans cet arrangement, fut même attentif au choix des termes et des dénominations. Il appela les riches d'un nom[18] qui indiquait les secours qu'ils donnaient à l'Etat; et, quant à ceux dont la fortune n'excédait pas quinze cents sols d'airain, ou qui même ne possédaient rien que leur personne, il les nomma prolétaires, pour faire voir qu'on leur demandait seulement de donner des enfants et une postérité à l'État. Dans une seule des quatre-vingt seize dernières centuries, il y avait numériquement plus de citoyens que dans la première classe tout entière. Ainsi, personne n'était exclu du droit de voter; mais la prééminence dans les suffrages était assurée à ceux qui étaient le plus intéressés au bon ordre de la République.[19] ……………………………………. XXIII. ………….. Carthage était de soixante-quinze ans plus ancienne que Rome, puisqu'elle fut fondée trente-neuf ans, avant la première olympiade; et, dans une antiquité beaucoup plus reculée, Lycurgue avait eu les mêmes vues ; ainsi, ce système d'égalité et ce mélange de trois formes de gouvernement me parait nous avoir été commun avec Carthage et Lacédémone. Mais, il est un avantage particulier à notre patrie, avantage auquel rien n'est préférable, que je tâcherai de caractériser avec le plus de justesse qu'il me sera possible, et qui semblera tel qu'on ne saurait, dans aucune autre république, découvrir quelque chose d'analogue. En effet, les éléments divers, dont j'ai parlé, furent d'abord réunis dans la Constitution de Rome, dans celle de Lacédémone et dans celle de Carthage, sans être pondérés par aucun équilibre; car, dans une société où quelqu'un est investi d'un pouvoir perpétuel, et surtout d'un pouvoir royal, eût-on d'ailleurs un sénat, comme à Rome, sous les rois, et à Lacédémone par les lois de Lycurgue, ou même le peuple exerçât-il une sorte de juridiction, comme du temps de notre monarchie, ce titre de roi emporte toujours la balance; et il est impossible qu'un État ainsi constitué ne soit pas un royaume, et de fait, et de nom. Or, cette nature de gouvernement est sujette aux révolutions, parce qu'il suffit de la faute d'un seul pour la précipiter vers l'extrémité la plus funeste. En elle-même, la royauté non seulement n'est pas une forme vicieuse; mais je la croirais même supérieure à tous les autres gouvernements simples, si je pouvais approuver aucune forme simple, en fait de gouvernement. Mais, cette préférence ne s'applique à la royauté qu'autant qu'elle garde son caractère ; et ce caractère, c'est que la puissance perpétuelle d'un seul, sa justice et sa haute sagesse garantissent la sûreté, l'égalité et le repos de tous les citoyens. Beaucoup de choses manquent au peuple gouverné par un roi, et d'abord la liberté, qui consiste non pas à dépendre d'un maître juste, mais à n'avoir point de maître.[20] ……………………….. XXIV. ………. Ce maître injuste et cruel eut quelque temps la fortune pour compagne dans toutes ses entreprises. Il subjugua tout le Latium, il prit Pometia, ville puissante et remplie de richesses : et maître d'une immense proie d'argent et d'or, il acquitta le vœu de son aïeul par la fondation du Capitule. Il forma des colonies ; et, fidèle aux usages du peuple, dont il tirait son origine, il fit porter à Delphes, au temple d'Apollon, des dons magnifiques, comme une offrande prélevée sur ses conquêtes. XXV. Ici commence et naît sous nos yeux ce cercle, dont je vous prie d'étudier le mouvement et la progression, dans le premier exemple qui s'en montre. Car, le point capital de la science politique, objet de nos discours, c'est de connaître la marche et les déviations des États, afin que sachant vers quel écueil incline chaque gouvernement, vous puissiez le retenir sur le penchant, ou d'avance lui opposer des barrières. Et d'abord, ce roi dont je parle, souillé du meurtre d'un vertueux souverain, n'avait plus l'âme assez libre, et, craignant pour lui-même une punition égale à la grandeur de son crime, il voûtait se faire craindre. Puis, du haut de ses victoires et de ses trésors, il s'enivrait d'un insolent orgueil, et ne pouvait ni se régler lui-même, ni modérer les passions des siens. Son fils aîné, ayant fait violence à Lucrèce, fille de Tricipitinus, épouse de Collatin, et cette femme noble et pure s'étant frappée d'un coup mortel, en expiation de son outrage, un homme éminent par le génie et la vertu, Junius Brutus, écarta de ses concitoyens le joug illégitime d'une odieuse servitude. Homme privé, il se chargea des destins de tout l'État; et, le premier parmi nous, enseigna cette grande maxime que, lorsqu'il s'agit de sauver la liberté publique, tout homme est magistrat. A sa voix, à son exemple, Rome indignée se souleva; et tout à la fois émue par la douleur si récente du père et des parents de Lucrèce, et par le ressouvenir de la tyrannie de Tarquin,[21] et des nombreuses injustices de ses fils et de lui-même, elle prononça le bannissement du roi, de ses enfants, et de toute la famille des Tarquins. XXVI. Remarquez ici comment du roi sortit le despote, et comment, par le crime d'un seul, une forme de gouvernement, de bonne qu'elle était, devint pernicieuse : voilà bien en effet le vrai caractère du despote, que les Grecs appellent tyran. Car ils réservent le nom de roi pour celui qui veille comme un père sur le peuple, et qui maintient ceux dont il est le chef dans la condition de vie la plus heureuse : forme de gouvernement bonne, je t'ai dit, mais qui touche, et, pour ainsi dire, incline à la plus dangereuse de toutes. En effet, un roi a-t-il dévié jusqu'à l'injustice dans le pouvoir, aussitôt il est tyran ; et l'imagination ne peut concevoir un monstre plus épouvantable, plus funeste, plus haï des hommes et des dieux, que le tyran qui, sous la forme humaine, surpasse en cruauté les plus hideux animaux. Peut-on en effet laisser avec vérité le nom d'homme à celui qui n'admet entre lui et ses compatriotes, entre lui et l'humanité tout entière, aucune communauté de droits, aucun partage de sentiments humains? Mais nous aurons une occasion plus naturelle d'en parler, quand notre sujet nous aura conduits à nous élever contre les hommes qui, au milieu d'une société dès longtemps affranchie, ont tenté l'usurpation du pouvoir. XXVII. Vous avez donc sous les yeux le premier modèle du tyran. Les Grecs ont voulu que ce nom désignât le mauvais roi ; et nos Romains ont appelé indistinctement roi, tout homme qui exercerait sur le peuple une puissance perpétuelle et sans partage. Ainsi, l'on a dit que Sp. Cassius, que Manlius, que Sp. Mælius avaient voulu s'emparer de la royauté ; et naguère, Tibérius Gracchus encourut la même accusation.[22] XXVIII. Lycurgue, à Lacédémone, forma, sous le nom de vieillards, un conseil trop peu nombreux, et de vingt-huit membres seulement, auxquels il attribua le droit suprême de délibération, tandis que le roi avait le droit suprême de commandement. Nos Romains imitant son exemple, et traduisant son expression, désignèrent ceux qu'il avait appelés vieillards, par le terme de sénat; c'est ce que fit Romulus, à l'égard des Pères, qu'il avait choisis; mais, dans cette combinaison, la puissance, l'ascendant, le nom de roi s'élève et prédomine toujours. D'une autre part, accordez au peuple quelque portion de pouvoir, comme Lycurgue et Romulus ; vous ne l'avez pas assouvi de liberté ; mais vous avez irrité l'ardeur de sa soif, en lui permettant de goûter ce breuvage. Au moins aura-t-il toujours suspendue sur sa tète la crainte qu'il ne s'élève un roi injuste. Elle est donc fragile, comme je l'ai dit, celte destinée d'un peuple, qui repose tout entière sur les inclinations et la volonté d'un seul homme. XXIX. Ainsi le premier exemple, le type, l'origine de la tyrannie nous apparaît dans cette république même, que Romulus avait instituée, de l'aveu des auspices ; et, nous ne l'empruntons pas à cette autre cité que, suivant les récits de Platon, Socrate s'était à lui-même figurée, dans les libres entretiens de ses promenades. Nous avons vu Tarquin, non par l'usurpation d'une puissance nouvelle, mais par l'injuste emploi de la puissance qu'il avait, renverser tout ce système d'État monarchique. Opposons à cet exemple celui de l'homme vertueux, sage, éclairé sur l'intérêt et la dignité de ses concitoyens, et qui est comme le tuteur et l'intendant de la République : car, c'est le nom qu'il faut donner à tout chef, à tout gouverneur d'une société. Cet homme est facile à reconnaître ; c'est celui qui, par le conseil et l'action, peut protéger l'État. Comme le nom de cet homme n'a pas encore été cité dans nos discours, et que nous aurons à en parler souvent dans la suite, essayons d'en tracer le caractère.[23] ………………………………………………………………… XXX. …………. Platon eut soin de supposer un territoire, des établissements, des fortunes réparties entre les citoyens avec une parfaite égalité; et, dans le cadre le plus étroit, il établit une république plus désirable que possible ; il n'a pas cherché ce qui pouvait exister, mais un modèle, sur lequel on pût étudier le jeu des affaires politiques. Pour moi, si toutefois j'y peux réussir, en m'attachant aux mêmes principes que Platon, je les essayerai, non sur un simulacre et une apparence de société, mais sur la plus puissante république qui fut jamais, de manière à paraître noter du doigt, pour ainsi dire, la cause de tout bien et de tout mal public. Après ces deux cent quarante deux années toutes monarchiques et quelque temps de plus encore, si l'on compte les interrègnes, Tarquin banni, le peuple romain prit pour le nom de roi autant de haine qu'il avait éprouvé de douleur, à la mort, ou plutôt à la disparition de Romulus. Et de même qu'il ne pouvait alors se passer d'un roi, ainsi, depuis le bannissement de Tarquin, il ne pouvait entendre prononcer ce même nom de roi. ………….. XXXI. Dans cet esprit, nos ancêtres bannirent Collatin, malgré son innocence, comme suspect par sa famille, et les autres Tarquins, en haine de leur nom. Dans ce même esprit, Valérius fit le premier abaisser les faisceaux devant le peuple, lorsqu'il parlait en public; et il fit reporter au pied du mont Vélia les constructions de sa demeure, s'étant aperçu que les travaux qu'il avait commencés pour la bâtir sur le sommet de cette colline, dans le même lieu où avait habité le roi Tullus, excitaient les soupçons du peuple. Ce fut également lui, et il mérita surtout ainsi le nom de Publicola, qui fit voter par le peuple la première loi reçue dans les Comices par centuries, pour défendre à tout magistrat de faire mettre à mort, ou frapper de verges le citoyen qui en appelait au peuple. Les livres des Pontifes attestent, il est vrai, que le droit d'appel existait contre les décisions des rois. Nos archives augurâtes le disent aussi ; et les douze tables indiquent par un grand nombre de lois, que l'on pouvait appeler de toute sentence et de toute condamnation. Le fait historique même, que les dix hommes qui rédigèrent les lois furent créés avec l'attribution de juger sans appel, montre assez que les autres magistrats n'avaient pas eu le même privilège. Lucius Valérius et Marcus Horatius, hommes sagement populaires, dans l'intérêt de la concorde, consacrèrent par une loi rendue sous leur consulat, le principe qu'il ne serait pas créé de magistrat qui jugeât sans appel; et les lois Porcia, ouvrage de trois citoyens du nom de Porcius, n'ajoutèrent, comme vous le savez, rien de nouveau que la sanction pénale. Publicola ayant promulgué cette loi en faveur de l'appel au peuple, fit sur le champ ôter les haches des faisceaux consulaires ; et le lendemain il se donna Sp. Lucretius pour collègue. Le nouveau consul étant le plus âgé, Publicola lui envoya ses licteurs ; et le premier il établit en usage que chacun des consuls alternativement serait suivi par les licteurs, d'un mois à l'autre, afin que les insignes du pouvoir ne fussent pas plus multipliés dans un État libre qu'ils ne l’étaient sous la royauté. Il ne se montra point, à mon sens, un homme ordinaire, lorsque, donnant au peuple une liberté modérée, il rendit seulement l'influence des grands plus facile et plus sûre. Je ne rebats pas en ce moment, sans motif, des faits antiques et surannés ; mais choisissant des personnages et des temps bien connus, je pose, relativement aux hommes et aux institutions, les modèles sur lesquels je réglerai ce qui me reste à dire. XXXII. A cette époque, le sénat maintint donc la République dans une telle situation que, chez ce peuple si libre, peu de choses se faisaient par le peuple, presque tout au contraire par l'autorité, les usages et les traditions du sénat, et que les consuls exerçaient une puissance annuelle par la durée, mais royale par sa nature et ses prérogatives. Cependant on conservait, avec beaucoup d'énergie, le point peut-être le plus décisif pour le maintien de la puissance des nobles, le principe que les résolutions du peuple ne pouvaient être définitives, sans l'approbation du sénat. Vers ce même temps, à peine dix ans après les premiers consuls, on vit l'institution de la dictature en la personne de T. Largius; et cette nouvelle espèce de pouvoir parut fort voisine d'une reproduction de la royauté. Cependant tout restait sous la haute influence des grands, le peuple n'opposant pas de résistance ; et dans ces temps, de grandes choses furent faites à la guerre par de vaillants hommes investis d'un grand pouvoir, soit dictateurs, soit consuls. XXXIII. Mais comme la nature des choses voulait que le peuple[24] s'arrogeât un peu plus de pouvoir, étant une fois affranchi des Rois; dans un intervalle assez court, seize ans après, sous le consulat de Postumus Cominius et de Sp. Cassius, il atteignit ce but. La raison manqua peut-être à cette entreprise ; mais la nature des Constitutions politiques l'emporte souvent sur la raison. Car retenez bien ce que j'ai dit en commençant : s'il n'existe dans l'État une juste compensation de droits, de devoirs et de prérogatives, de manière à donner assez de puissance aux magistrats, assez d'influence aux délibérations des grands, assez de liberté au peuple, cette forme de gouvernement ne peut se conserver immuable. Ainsi, parmi nous, les dettes excessives des citoyens ayant mis le désordre dans l'État, le peuple se retira sur le mont Sacré, et ensuite sur l'Aventin. L'austère discipline de Lycurgue n'enchaîna pas non plus les mouvements d'une population grecque. A Sparte aussi, sous le règne de Théopompe, les cinq magistrats que l’on appelait Éphores, en Crète, les dix magistrats nommés Régulateurs, furent établis en opposition à la puissance royale, comme les tribuns, parmi nous, pour balancer l'autorité consulaire. XXXIV. Il y avait peut-être pour nos aïeux quelques moyens de remédier à ce fléau de la dette, moyen que Solon[25] n'avait pas ignoré, dans une époque assez récente, et que notre sénat ne négligea point, le jour où, par l'indignation qu'excita l'odieuse violence d'un créancier, tous les citoyens enchaînés comme débiteurs furent délivrés, et l'esclavage pour dettes désormais interdit. De tout temps, même lorsque les plébéiens succombaient sous le poids des dépenses qu'avait entraînées le malheur public, on chercha, dans l'intérêt du salut général, quelques secours et quelques soulagements à leurs maux ; mais le sénat ayant une fois mis en oubli cette politique, ce fut l'occasion dans Rome d'un changement qui, par la création de deux tribuns dans une émeute populaire, affaiblit le pouvoir et l'ascendant du sénat. Toutefois, il lui resta de la force et de la majesté ; elle tenait à la personne de ces hommes aussi sages que courageux, qui protégeaient la République par leurs armes et par leur prudence, et prenaient d'autant plus d'empire sur les esprits que, supérieurs aux autres en dignités, ils leur cédaient dans la recherche des plaisirs, et ne les surpassaient pas en richesses. Leurs vertus publiques étaient d'autant plus agréables au peuple, que, dans les intérêts privés, ils étaient empressés à servir chaque citoyen, de leurs efforts, de leurs conseils et de leur fortune. XXXV. Dans cette situation de l'Etat, Spurius Cassius, enhardi par l'extrême faveur dont il jouissait auprès du peuple, cherchant à s'emparer de la puissance royale, fut accusé par le questeur ; et, comme vous le savez, le père même de Cassius, après avoir déclaré qu'il avait la conviction du crime de son fils, le fit mourir de l'aveu du peuple. Environ cinquante-quatre ans après le premier consulat, Tarpéius et Aternius, consuls, firent une chose agréable au peuple, en proposant, dans les Comices par curies, l'établissement d'une amende à substituer aux peines corporelles. Vingt années après, comme les censeurs L. Papirius et Pinarius avaient, par l'application de ces amendes, fait passer à l'Etat les troupeaux entiers des particuliers, la confiscation en nature fut remplacée par une modique évaluation pécuniaire, d'après une loi rendue sous le consulat de C. Julius et de Papirius. XXXVI. Mais quelques années auparavant, à une époque où le sénat avait la plus haute influence, de l'aveu du peuple qui se montrait soumis et docile, un système nouveau fut adopté : les consuls et les tribuns abdiquèrent leurs charges; et on créa dix hommes, revêtus d'une grande autorité sans appel, pour exercer le pouvoir souverain et rédiger des lois. Après avoir composé, avec beaucoup de prudence et d'équité, dix tables de lois, ils nommèrent pour leur succéder l'année suivante, d'autres décemvirs, qui ne montrèrent pas la même justice et la même loyauté. On cite cependant le trait remarquable d'un des membres de ce collège, de Julius : c'est à l'égard du patricien Sestius, dans la chambre duquel il déclarait qu'un cadavre avait été exhumé, sous ses yeux. Quoiqu'il eût juridiction suprême, comme pouvant juger sans appel, le décemvir admit des cautions, parce qu'il ne pouvait, dit-il, faire oubli de cette admirable loi, qui ne permettait qu'aux Comices assemblés par centuries de statuer sur la vie d'un citoyen romain. XXXVII. Une troisième année suivit, sous l'autorité des mêmes décemvirs, et sans qu'ils aient voulu se donner de successeurs. Dans cette situation politique, dont j'ai déjà parlé comme ne pouvant être durable, parce qu'elle n'est pas égale pour tous les ordres de l'État, toute la puissance publique était aux mains des grands, par la nomination unique de dix hommes de la première noblesse, sans le contrepoids des tribuns, sans l'adjonction d'aucune autre magistrature, et sans recours devant le peuple contre le fouet et la hache. Ainsi, l’injustice de ces hommes produisit soudainement un grand désordre, et changea toute la face de la République. Ils ajoutèrent deux tables de lois tyranniques; et tandis que l'alliance du mariage est toujours accordée, même à des peuples étrangers, ils prohibèrent, par la plus odieuse des lois, toute alliance semblable entre les plébéiens et les familles des sénateurs, ce qui fut dans la suite abrogé par un plébiscite de Canuleius. Enfin, ils portèrent dans tout leur gouvernement la dureté, la débauche et l'avarice. On sait, et tous les monuments littéraires racontent comment Virginius, poussé par les fureurs d'un décemvir, à immoler sa fille[26] de sa propre main dans la place publique, ayant fui désespéré vers l'armée romaine, qui était campée sur le mont Algide, les soldats abandonnèrent aussitôt la guerre qu'ils avaient à soutenir, et se rendirent d'abord sur le mont Sacré, comme on l'avait vu déjà dans une occasion semblable, puis sur l'Aventin, qu'ils occupèrent en armes. ………………………………………… XXXVIII. Scipion ayant ainsi parlé, comme tout le monde paraissait attendre en silence la suite de son discours, Tubéron dit alors : Puisque mes aînés se taisent et ne vous demandent rien, Scipion, vous allez apprendre de moi ce que votre discours me laisse à désirer. A la bonne heure, et très volontiers, repartit Scipion. Eh bien! dit Tubéron, vous me paraissez avoir fait l'éloge de la constitution romaine, tandis que la question de Lælius portait sur toute espèce de gouvernement, et n'était pas bornée seulement au nôtre. Et de plus, je n'ai pas appris dans votre discours par quels principes, par quelles lois, par quelles mœurs nous pouvons fonder ou maintenir ce gouvernement que vous louez tant. XXXIX. Scipion. Je pense que nous aurons bientôt une occasion plus naturelle de discuter la question de rétablissement et de la durée des États. Quant à la meilleure forme de gouvernement, je croyais sur ce point avoir suffisamment répondu à la question de Lælius ; car j'avais d'abord reconnu trois formes de gouvernements raisonnables, puis trois espèces de gouvernements funestes, qui sont l'opposé des premiers. J'avais dit qu'aucun de ces premiers gouvernements n'était parfaitement bon; et j'avais désigné comme préférable à chacun d'eux celui qui serait habilement formé de leur mélange. Que si j'ai donné notre République en exemple, cela n'avait point pour objet de définir la meilleure forme de gouvernement : la chose était facile, sans citer aucun exemple; mais j'ai voulu, dans l'existence même d'un grand État, rendre présent et visible ce que le raisonnement et la parole n'auraient fait que décrire. Maintenant, si vous cherchez le meilleur mode de République, indépendamment de tout exemple particulier, consultez l'image que vous présente la nature.[27] ………….. XL. …………. Voici le caractère que je cherche depuis longtemps et auquel j'étais impatient d'arriver. Lælius. Celui du politique, peut-être? Scipion. Celui-là même. Lælius. Vous en avez dans ce moment assez de modèles sous les yeux, à commencer par vous-même. Plût à Dieu, reprit Scipion, que le sénat nous offrît relativement le même nombre! Mais enfin, le politique c'est l'homme qui, comme nous l'avons vu souvent en Afrique, assis sur le.col d'un animal monstrueux, maîtrise et gouverne ce colosse, et plutôt même par le signe que par le toucher, le conduit où il veut. Lælius. Je le sais, et je l'ai vu, lorsqu'en Afrique je vous servais de lieutenant. Scipion. Aussi un Numide, un Carthaginois parvient à conduire une seule de ces bêles monstrueuses, lorsqu'elle est dressée et familiarisée avec les habitudes de l'homme. Mais le principe qui réside au fond de l'âme humaine, et qui en fait partie sous le nom d'intelligence, doit soumettre au frein et dompter un monstre multiple et bien autre ment indocile : aussi, rarement il y parvient; car elle a besoin d'être tenue sous la main, cette bête féroce qui s'abreuve de sang, qui s'emporte si aisément à toute cruauté, et peut à peine se rassasier de victimes humaines.[28] ………………………………………………….. XLI. …………………… Je vois maintenant, dit Lælius, quelle œuvre, quelle tâche vous imposez à cet homme rare que j'attendais. Une seule, reprit Scipion; car ce seul point comprend tout le reste : je lui impose le devoir de ne jamais suspendre son action et sa surveillance sur lui-même, d'exciter les autres à l'imiter, et d'être enfin, par l'éclatante pureté de son caractère et de sa vie, comme un miroir offert à ses concitoyens. Car, de même que les frémissements des cordes, les accents des flûtes et les inflexions du chant et de la voix, forment un concert mélangé de sons distincts, et dont les moindres altérations, les moindres dissonances offenseraient une oreille exercée;[29] de même enfin, que ce concert, par l'habile direction des voix les plus dissemblables, produit l'accord et l'harmonie: ainsi, un Etat sagement composé de la réunion de trois ordres inégaux, se met en accord par le jeu combiné des éléments les plus divers; et ce que les musiciens appellent l'harmonie dans le chant, est l'union dans l'état social, l'union, le plus fort et le meilleur gage du salut public, mais impossible à conserver, sans la justice.[30] ………………………………………………………………………. XLII. …………….. Scipion reprit : Je partage cette opinion, et je vous déclare que nous devons regarder comme nul tout ce qui a été dit jusqu'à ce moment sur la République, et que nous ne devons point passer plus avant, s'il ne demeure établi, qu'il est faux que la chose publique ne puisse être gouvernée, sans le secours de l'injustice, et qu'il est au contraire de toute vérité, que la chose publique ne peut être gouvernée, sans une suprême justice. Mais, si vous le voulez, c'est assez pour aujourd'hui : remettons la suite à demain ; car beaucoup de choses nous restent encore. Tout le monde ayant consenti, l'entretien du jour fut terminé.
[1] Le commencement de ce livre nous paraît présenter une lacune, dont l'éditeur de Rome n'indique pas l'étendue, mais qui n'est que trop évidente. On sait que la méthode de Cicéron était d'ouvrir chacun de ses dialogues philosophiques par un préambule, où il parlait en son nom. Il se plaisait ensuite à introduire ou à ramener sur la scène les différents interlocuteurs; et il prodiguait ces petits détails, dont les anciens ne sont pas toujours assez avares, et où brillent cette élégance délicate et cette fleur d'urbanité romaine, qu'il opposait à l'atticisme de Platon. Il a usé de cet art avec un goût exquis dans le traité des Lois. Les livres suivants du traité de la République nous montreront, au moins dans de précieux fragments, plus d'un modèle de ces épisodes qui reposent l'attention fatiguée par la continuité du dialogue, et l'élévation ou la gravité des matières. Ici toute introduction semblable nous manque : les premiers mots sont même en partie mutilés; et quelques lettres ont été suppléées par l'éditeur. [2] « Une des causes de la prospérité de Rome, dit Montesquieu, « c'est que ses rois furent tous de grands personnages. On ne trouve point ailleurs, dans les histoires, une suite non interrompue de tels hommes d'État et de tels capitaines. » Et dans un autre endroit, il ajoute : « Rome ayant chassé les rois, établit les consuls annuels ; c'est encore ce qui la porta à ce haut degré de puissance. Les princes ont dans leur vie des périodes d'ambition ; après quoi d'autres passions et l'oisiveté même succèdent: mais la république, ayant des chefs qui changeaient tous les ans, et qui cherchaient à signaler leur magistrature pour eu t obtenir de nouvelles, il n'y avait pas un moment de perdu pour l'ambition. » [3] Cicéron, dans le traité des Lois, se moque de cette tradition sur la naissance merveilleuse du fondateur de Rome; et ici même, il la traite de fable. Il ne fait d'ailleurs aucune recherche critique sur ces premières antiquités de Rome, que les modernes ont cru pouvoir éclaircir. Tite-Live se borne à dire, avec une fierté de style très majestueuse, mais peu concluante pour la fidélité historique : « S'il doit être permis à quelque peuple de s'attribuer une origine sacrée, et de faire remonter sa naissance jusqu'aux dieux, telle est la gloire du peuple romain dans la guerre, que, lorsqu'il proclame de préférence le dieu Mars pour son père, pour le père de son fondateur, les nations de la terre doivent le souffrir avec la même résignation qu'elles souffrent son empire. » Si cui populo licere oportet consecrare origines suas, et ad deos referre auctores, ea belli gloria est populo romano, ut, cuum suum conditorisque sut parentem Martem potissimum ferat, tam et hoc gentes humanæ patiantur œquo animo, quam et imperium patiuntur. [4] Cette digression sur les inconvénients du voisinage de la mer brille, dans le texte original, d'une beauté d'élocution, qui n'appartient qu'à l'orateur romain. Les idées, nous en convenons, sont un peu arriérées; ce sont quelques belles pensées d'Aristote et de Platon. Tout cela ne rentra guère dans nos systèmes modernes. Navigation, commerce, échanges, voilà les mobiles de notre civilisation : et voilà ce que les publicistes de l'antiquité semblaient croire pernicieux à la force et à la durée des États. Notre Liberté même a pour appui le luxe, que les Républiques anciennes proscrivaient, comme le fléau de la leur. Ces différences, qui ne sont pas des contradictions, trouveraient leur explication naturelle dans des causes que nous ne pouvons développer ici ; mais elles font nécessairement que la politique des anciens nous paraît trop vague, trop remplie de généralités philosophiques. Aujourd'hui, on constitue un État avec l'économie politique, c'est-à-dire avec la science de produire et de vendre. Les anciens avaient la simplicité de compter pour quelque chose le patriotisme, les mœurs, les vertus publiques. [5] Il paraît que Cicéron avait écrit d'abord d'une manière générale, que toutes les villes du Péloponnèse étaient maritimes, et que cette erreur fut relevée par la vigilante critique d'Atticus : on lira avec plaisir tout ce détail tiré de la correspondance de Cicéron. « J'en viens, écrit-il à son ami, à l'observation que vous t me faites, dans la première page de votre lettre. Ce n'est pas sur le témoignage de quelque méchant auteur, que j'ai avancé que toutes les villes du Péloponnèse étaient maritimes; c'est sur la foi de Dicéarque, dont vous faites vous-même beaucoup de cas. Dans sa description de la descente de l'antre de Trophonius, Chéron prouve, par beaucoup de raisons, que les Grecs ont mal fait de bâtir tant de villes sur le bord de la mer; et il compte pour maritimes toutes celles du Péloponnèse. Quoique j'estime fort cet auteur, qui me paraît avoir une grande connaissance de l'histoire, et qui d'ailleurs a vécu dans le Péloponnèse, cela ne laissa pas de m'arrêter ; et je proposai mon doute à Dionysius. Il fut d'abord surpris ; mais, comme il se fie aussi volontiers à Dicéarque, que vous à Vestorius, et moi à Cluvius, il me dit que je pouvais m'en rapporter à cet auteur. Il prétend qu'il y a dans l'Arcadie une ville maritime nommée Lépréon. Pour Téné, Aliphéra et Critia, il croit que ce sont des villes modernes; et il le prouve par le dénombrement, que fait Homère, de toutes celles qui armèrent des vaisseaux pour la guerre de Troie, où elles ne sont point comprises. Tout ce que j'ai dit là-dessus, je l'ai copié mot pour mot de Dicéarque. » L. VI, lett. 2. On peut juger par ce passage curieux combien les notions géographiques avaient alors peu de certitude et d'étendue. [6] Fidèle au plan de tout rapporter à la Constitution romaine, et de faire plutôt une histoire qu'une théorie politique, Cicéron va successivement examiner l'état de Rome, aux diverses époques de sa durée, à dater de ses rois. Ce plan, s'il produisait quelques lumières nouvelles sur un sujet fort obscur, aurait beaucoup plus d'intérêt pour nous que des idées purement spéculatives. Mais Cicéron ne va guère au delà des traditions connues, et qui ont souvent exercé le scepticisme des savants. Il prend l'histoire romaine à peu près telle que nous l'avons; et ses réflexions ne paraissent pas supposer d'autres faits que ceux dont Tite-Live a rempli ses éloquents récits. On sait que la plupart de ces faits, surtout dans ce qui regarde les premiers siècles de Rome, ont été controversés par la Critique moderne. Ce texte, repris de nos jours par les savants d'Allemagne, avait fort occupé nos érudits du dix-septième siècle; et il n'est pas inutile de dire ici quelques mots de la question. Dans le sixième volume des Mémoires de l'Académie des Inscriptions, se trouve une dissertation, où M. de Pouilly essaye d'ôter toute authenticité aux premiers siècles de l'histoire romaine, en établissant que les premiers historiens de Rome, Cincius et Fabius Pictor, vivaient au moins cinq cents ans après la fondation de cette ville, et que tous les anciens monuments, qu'ils auraient pu consulter, avaient péri dans l'incendie de Rome par les Gaulois. Il s'attache ensuite à montrer, que plusieurs faits rapportés par Tite-Live sont des copies évidentes de traditions grecques. Il retrouve les Horaces, les Curiaces, et tout ce merveilleux récit, dans un fragment des Arcadiques de Démarate, conservé par Stobée, et où il s'agit d'une guerre entre deux petites villes d'Arcadie, Tegée et Pherée, qui choisirent pour terminer leur querelle chacune trois guerriers, frères jumeaux; sans qu'il y manque aucune circonstance, jusqu'à l'amour de la sœur du vainqueur pour l'un des vaincus, et jusqu'au meurtre de cette sœur infortunée. M. de Pouilly retrouve également Scévola dans un héros grec, célébré par l'historien Agatharchide. Il essaye ensuite de prouver que, dans le défaut absolu de monuments primitifs, les traditions menteuses do l'orgueil romain se trouvent cependant contredites quelquefois par des témoignages étrangers. A la défaite des Gaulois sur les ruines de Rome, et à la victoire de Camille racontée par Tite-Live, il oppose le récit de Polybe, suivant lequel les Gaulois, ayant assiégé le Capitole dorant neuf mois, sur l'avis que leur propre territoire était ravagé par les Vénètes, se retirèrent volontairement, après avoir reçu la rançon des Romains. De tout cela le savant académicien conclut, qu'indépendamment des prodiges ridicules et des fables manifestes, qui défigurent l'histoire des premiers siècles de Rome, cette histoire ne mérite aucune confiance, sous le rapport même défaits plus graves, et qui offrent plutôt le caractère de l'héroïsme que celui du merveilleux. Une conclusion si sévère a été appuyée de preuves et de conjectures nouvelles, dans la curieuse dissertation de Beaufort, sur l'incertitude de l'histoire des premiers siècles de Rome. Cependant, cette opinion a trouvé, dès l'origine, de savants contradicteurs. Un membre de l'Académie des belles-lettres, le docte Sallier, réfuta le scepticisme de son collègue M. de Pouilly, dans deux mémoires très bien faits, où il établit surtout l'existence de monuments antérieurs au cinquième siècle de Rome, et consultés par les premiers auteurs qui écrivirent son histoire. Cicéron parie de ces monuments dans le traité de l'Orateur. « Depuis les commencements de Rome, dît-il, jusqu'au pontificat de Publius Mucius, le souverain pontife, en mémoire des événements publics, tête liait constamment un registre des faits de chaque année, et les inscrivait sur des tables, qu'il laissait en vue dans sa maison, pour que le peuple eût la facilité d'en prendre connaissance. Et c'est là ce que l'on nomme encore aujourd'hui les Grandes Annales. » Ailleurs, Cicéron disait, parlant de ce même recueil : « Où peut-on puiser plus aisément que dans les Annales la connaissance de nos guerres et de toute notre discipline politique? d'où peut-on recueillir, soit pour la conduite, soit pour le discours, un plus riche trésor d'exemples imposants et d'irrécusables témoignages? » C'est aussi de ces vieux monuments que, dans un autre passage, il tire dos inductions sur l'éloquence de quelques orateurs des premiers temps de la République. Enfin, il nomme encore ces Annales dans le traité des Lois, au moment même où il convient que les Romains n'ont pas eu jusqu'à ce jour une histoire digne d'eux, et où il se fait prier par Atticus d'entreprendre ce-grand ouvrage. Voilà donc un point bien prouvé, l'existence d'Annales non interrompues, écrites par le souverain pontife, renfermant un grand nombre d'événements, d'anecdotes, et mémo des analyses, des fragments de discours prononcés au sénat, ou devant le peuple. C'étaient ces recueils anciens, c'étaient les livres des augures, et les hymnes des prêtres saliens, que Varron avait étudiés, et où il avait puisé cette connaissance profonde de l'antiquité romaine, que Cicéron admire avec enthousiasme, et qui sans doute reposait sur quelque chose de réel et d'authentique. — A ce premier genre de monuments, il faut ajouter des actes publics : par exemple, ces tables de dénombrement, dont parle Denys d'Halicarnasse, et dont Varron cite un passage, dans son ouvrage sur la Langue latine. Il faut ajouter les anciens traités de paix, ou d'alliance, tels que celui dont Denys d'Halicarnasse parle en ces termes : « On voit encore aujourd'hui, dans le temple de Jupiter-Fidius, que les Romains appellent Sancus le traité de Tarquin avec ceux de Gabies; c'est un bouclier de bois couvert de la peau du bœuf qui fut immolé, après le serment d'alliance ; et sur cette peau se lisent écrits en caractères anciens, les articles et les conditions du traité. » Polybe traduit littéralement un autre traité des premiers jours de la République, celui que les Romains firent avec les Carthaginois pour des intérêts de commerce, sous le consulat de Junius Brutus et de Marcus Horadius : et il annonce que l'original de ce traité se conserve encore de son temps dans le trésor des édiles, près du temple de Jupiter Capitolin. Tel était le nombre des monuments de cette nature, qu'au rapport de Suétone, dans l'incendie du Capitole, sous Vespasien, trois mille tables d'airain, qui contenaient, presque depuis l'origine de Rome, les sénatus-consultes, les plébiscites, les chartes d'alliance et de concession, furent détruites ou perdues, et que l'empereur à force de soins, en faisant rechercher d'autres exemplaires des mêmes actes, recomposa ces précieuses archives, et, comme dit l'historien, « rétablit ce superbe et antique mobilier de l'empire. » Instrumentum imperii pulcherrimum ac vetustissimum. A côté de ces monuments ainsi conservés dans les archives publiques de l'État, il faut placer ces lois des Douze Tables, que l’on faisait apprendre de mémoire aux enfants, et que Cicéron commente et discute avec tant de respect. On ne peut douter même qu'il ne se fût conservé des lois plus anciennes, et du siècle des rois : Aulu-Gelle et Servius en ont rapporté de courts fragments; enfin, Tite-Live cite plusieurs fois les livres écrits sur le lin, libri lintei, qui ne pouvaient être autre chose que d'anciennes annales publiques, rédigées dans les premiers temps de la grossièreté romaine. Mémoires contemporains, registres pontificaux, actes civils, lois écrites, traités, inscriptions, il existait donc des documents de diverse nature pour les premiers historiens de Rome ; et on ne peut démentir leurs récits par un pyrrhonisme universel fondé sur la supposition de leur ignorance, — Ces remarques laissent, il est vrai, subsister de grandes difficultés, de grandes invraisemblances dans l'histoire des premiers temps de Rome. Comment concevoir, par exemple, ce calcul chronologique qui remplit une durée de 242 ans par une succession de sept rois électifs, dont trois seraient morts assassinés, et dont le dernier a été chassé du trône fort longtemps, avant sa mort? Cela est bien loin de la supputation de Newton, qui n'admet pour les règnes héréditaires qu'une durée commune et probable de vingt à vingt-deux ans. Comment supposer aussi que Rome ait pu, cent ans après son origine, sous le règne d'Ancus Martius, construire ces étonnants travaux de magnificence et de salubrité; que la République, dans sa puissance, avait peine à réparer, que l'incurie du moyen âge a laissé dépérir, et dont la grandeur fait dire à Montesquieu : « On commençait déjà à bâtir la ville éternelle. » — Tout cela, sans doute, présente un problème fort difficile à résoudre, et que Cicéron n'éclairait pas. Il faut même avouer que son témoignage augmente plutôt le scepticisme; car, après avoir beaucoup raisonné sur les Institutions de Romulus et de ses successeurs, il lui échappe de dire que, « de toute cette époque, on ne sait bien positivement que les noms des rois. » La sagacité des savants pourra donc, autorisée par cet aveu, faire de nouvelles conjectures, et supposer, si elle veut, que Rome étant d'abord une colonie étrusque, reçut dès l'origine les arts et la civilisation de l'Étrurie ; qu'elle eut, sous le règne de ses rois, une puissante marine; qu'elle déchut, dans la suite. Les érudits pourront enfin deviner et même affirmer tout ce que Cicéron ne savait pas. Nous nous sommes bornés à exposer les deux points de vue de la question, persuadés qu'en matière si obscure, il faut douter de son scepticisme, autant même que des choses auxquelles on l'applique. [7] Cicéron, dans le traité des Lois, raille beaucoup cette prétendue apparition de Romulus, et la range sur la même ligne que la fable de Borée et d'Orithye. Hais ce qui est remarquable ici, c'est l'induction qu'il tire de cette marne fable, et l'opinion qu'il exprime touchant la civilisation des peuples d'Italie. Les Romains, héritiers de la civilisation étrusque, ou de toute autre, étaient-ils en effet un peuple éclairé dès son origine? Cela contredit les notions ordinaires; mais cela s'accorderait mieux avec ces grands travaux achevés incontestablement, avant la République, et qui semblent n'avoir pu appartenir qu'à une époque de puissance et d'industrie, [8] Tite-Live, qui est généralement conforme à Cicéron, sur ces premiers faits de l'histoire romaine, rapporte que l'autorité était ; exercée par une réunion de dix sénateurs, dont un seul avait les faisceaux et les licteurs, et qui se renouvelaient, tous les cinq jours; il ajoute que cet état provisoire, se prolongea pendant une année, et que le peuple, lassé de tant de maîtres, redemanda la royauté. [9] On ne s'attendra pas, sans doute, à nous voir ici soutenir une thèse contre Scipion; d'ailleurs, la question est jugée, depuis longtemps ; et il suffit d'ajouter un fait. Depuis tant de siècles, dans l'Europe moderne, une seule monarchie a perdu son existence et a été rayée du nombre des États indépendants, celle eu la royauté fut élective. [10] A cette belle peinture des institutions de Numa, opposerons-nous le pyrrhonisme de Beaufort, qui, dans son savant ouvrage sur la République romaine, doute de l'époque et de la durée du règne de Numa? Remarquons seulement que Cicéron désigne ici formellement les lois de Numa, conservées dans les monuments publics, et qu'il invoque, sur un autre point, le témoignage, ou plutôt le silence des Annales publiques : ce qui du moins semble toujours attester l'existence et l'authenticité de ces Annales. Au reste, les savants pensent que, dans toutes les suppositions, le culte religieux établi par Numa, ne se maintint pas dans sa forme première, et ne ressemblait pas à ce que nous connaissons de la religion des Romains. On sait à ce sujet l'anecdote rapportée par Tite-Live et Pline : vers le septième siècle de la République, un Romain découvrit dans son champ un coffre de pierre renfermant les livres de Numa sur le droit du sacerdoce et sur la philosophie, écrits, quelques-uns en grec, d'autres en latin. Ces livres portés à Rome et lus par le préteur, sur la déclaration de ce magistrat qu'ils étaient en grande partie destructifs de la religion établie, furent, par l'ordre du sénat, brûlés dans la place publique. Montesquieu donne beaucoup d'importance à ce fait dans une dissertation particulière intitulée, de la politique des Romains dans la Religion; il y voit une preuve du soin constant des législateurs de Rome pour subordonner le culte religieux aux institutions sociales. Tite-Live, à l'endroit où il raconte l'anecdote curieuse des livres de Nuira trouvés dans le coffre de pierre, parle aussi de cette tradition qui faisait Numa contemporain et disciple de Pythagore; et, en ajoutant qu'elle avait été accréditée par l'historien Valérius Antias, il la rejette comme une fable. [11] « De tous les peuples du monde, le plus fier et le plus hardi, mais tout ensemble le plus réglé dans ses conseils, le plus constant dans ses maximes, le plus avisé, le plus laborieux, et enfin le plus patient, a été le peuple romain. De tout cela s'est formée la meilleure milice et la politique la plus prévoyante, la plus ferme et la plus suivie qui fut jamais. » — Bossuet, Discours sur l’histoire universelle.) [12] Une lacune interrompt la suite de ce récit, et mutile le sens de la dernière phrase, que la traduction a facilement suppléée. L'éditeur de Rome croit pouvoir intercaler ici un passage cité par saint Augustin, comme appartenant au second livre du traité de la République. Voici le sens de ce court fragment, que nous avons rejeté dans les notes, et qui dédommagera fort peu le lecteur des lacunes si fréquentes de notre manuscrit palimpseste. « Ce genre de mort ne fît pas croire cependant que Tullus Hostilius eut été reçu parmi les dieux, sans doute parce que les Romains ne voulurent pas rabaisser le prix d'une apothéose admise pour Romulus, en l'accordant facilement à un autre. » Ce peu de mots prouve seulement que Cicéron avait rapporté la mort de Tullus Hostilius, comme on la trouve racontée dans Tite-Live. Dirai-je que cette mort, arrivée par un coup de tonnerre, a donné lieu à un savant moderne, à Lévesque, de supposer que Tullus était fort habile, ou du moins fort curieux en électricité, et qu'il avait péri par une opération mal dirigée? [13] La répétition de cette circonstance, à l'avènement de chacun de ces rois est fort curieuse. Il ne s'agit pas simplement d'y voir la forme plus ou moins limitée, plus ou moins républicaine, que prenait l'autorité de ces rois électifs. Mais ne peut-on pas en conclure qu'il existait, dans les archives romaines, quelques preuves de l'observation de cette formalité singulière, si soigneusement marquée par Cicéron? et dès lors l'histoire des premiers rois de Rome ne pourrait-elle pas paraître plus authentique et mieux attestée qu'on ne le suppose ? [14] Ce fait avoué par les historiens romains, qu'un Grec fut le cinquième roi de Rome, a paru favoriser les conjecturée des critiques modernes qui ne voient dans Rome qu'une colonie grecque. Mais cette conjecture n'explique rien. Avant ce roi, Corinthien d'origine, Rome avait déjà construit de grands ouvrages qui semblent supposer une civilisation florissante. Ancus Martius fit bâtir, disent tous les historiens, le fameux aqueduc appelé de son nom, et qui, pendant plusieurs siècles, suffit pour fournira Rome, en abondance, une eau plus salutaire que celle du Tibre. Le témoignage de Pline le naturaliste à cet égard est curieux. « De toutes les eaux de l'univers, dit-il, la plus célèbre pour la fraîcheur et la salubrité, c'est l'eau Martia, illustrée par la reconnaissance et tes louanges de Rome, à laquelle les dieux l'ont accordée, parmi tant de bienfaits. Elle s'appelait autrefois Aufeia, et sa source Pitonia. Elle prend naissance dans les montagnes les plus reculées des Abruzzes. Elle traverse le pays des Marses, et le lac Ficin, comme si elle voulait gagner Rome. Bientôt elle se perd dans une caverne, d'où elle sort près de Tibur, et continue son chemin, sous des voûtes construites dans k une longueur de neuf mille pas. Ancus Martius, un des rois de Rome, forma le premier l'entreprise de la conduire dans la ville. Dans la suite, Quintus Martius Rex s'en occupa pendant sa préture, et Agrippa répara de nouveau ce monument. » Clarissima aquarum omnium in toto orbe, frigoris salubritatisque palma, prœconio urbis, Martia est, inter reliqua deum munera, urbi tributa, Vocabatur hœo quondam Aufeia, fons autem ipse Pitonia. Oritur in ultimis montibus Pelignorum : transit Marsos et Fucinum lacum, Romam non dubie petens. Mox in specus mersa in Tiburtina se aperit, novem millibus passibus, fornicibus structis perducta. Primus eam in urbem ducere auspicatut est Ancus Martius, unus e regibus, postea, Q. Martius Rex in prœtura; rursusque restituit M. Agrippa. (Pline, Hist. nat. lib. XXXI, cap. xxiv.) N'est-il pas assez remarquable qu'il se trouve une conformité de noms entre le roi que Pline suppose le premier fondateur de ce grand ouvrage, et le préteur qui le fit reconstruire, et que cette ressemblance soit encore augmentée par le surnom de Rex que portait ce magistrat? Ne peut-on pas en conclure ici quelque méprise de l'orgueil romain, qui se serait plu à reculer la date d'un si précieux monument, pour illustrer à la fois ses antiquités et le monument môme? C'est ainsi que le doute peut encore se mêler aux faits en apparence les plus avérés des premiers temps de Rome. [15] Cicéron laisse de côté la fable ridicule rapportée par Tite-Live, et ne nous dit pas que l'augure Nævius, en preuve de la vérité de son art, ait fait le miracle de couper une pierre avec un rasoir. Pline rapporte que l’on voyait à Rome, de son temps, une statue élevée en l'honneur de cet augure par le roi. C'est une preuve de plus de l'observation souvent faite, que les monuments, même contemporaine, ne démontrent nullement la vérité des traditions. [16] Cicéron va donner d'assez grands détails sur les Institutions établies par Servius. Ces détails, exprimés avec beaucoup d'élégance et de précision, portent sur un point soigneusement exposé par Tite-Live et par Denys d'Halicarnasse. Il semble difficile de douter, d'après le récit circonstancié de ces écrivains, qu'ici l'histoire romaine ne prenne un caractère plus authentique, et que les lois de Servius n'aient, en effet, eu beaucoup d'influence sur la Constitution de la république romaine. Tacite, qui ne ménage pas les fausses traditions des premiers temps de Rome, dit dans ses Annales : « Servius fut principalement créateur de lois auxquelles devaient obéir même les rois. » Prœcipuus Servius Tulliu sanctor legum fuit quis et reges obtemperarent. Quoi qu'il en soit de la nature de ces lois, celles qui étaient relatives à la distribution des suffrages subsistèrent, du moins en partie, sous la République; et les changements qu'on y introduisit, l'application plus restreinte ou plus étendue qu'on leur donna, furent les plus grands événements de la politique intérieure de Rome. Ainsi, la substitution du vote par Tribus au vote par Centuries, qu'avait établi Tullus, cette substitution tantôt partielle, tantôt générale, tantôt appliquée à l'élection pour certaines magistratures, tantôt à l'adoption des lois, souvent même au jugement des accusés, fut la révolution à la fois la plus décisive et la plus disputée que Rome éprouva dans sa durée républicaine. Il est donc fort curieux de connaître, d'après Cicéron, le système de ces fameuses centuries. [17] « Servius Tullius suivit dans la composition de ses classes l'esprit de l'aristocratie. Nous voyons dans Tite-Live et dans Denys d'Halicarnasse comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avait divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formaient six classes : et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries, les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière; et chaque centurie n'ayant qu'une voix, c'étaient les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage plutôt que les personnes. » (Montesquieu, Esprit des Lois.) [18] L'allusion intraduisible du texte tient à l'emploi du mot latin assiduus, dérivé des deux mots asses dare, donner de l'argent, et appliquée par Servius à la dénomination des riches. [19] Une lacune de plusieurs pages interrompt cette analyse des lois de Servius. Là se trouvaient des réflexions sur la monarchie mixte, auxquelles se rattache probablement une phrase conservée par le grammairien Nonius, et qui est comme un extrait de la théorie politique développée dans le premier livre. Voici la traduction de cette phrase : « La meilleure constitution politique est celle qui, mêlant dans une juste mesure les trois principes monarchique, aristocratique et populaire, n'effarouche pas les âmes, en les aigrissant par la punition. » Ces réflexions conduisaient Scipion à parler de Carthage et de Lacédémone. [20] Le but de ces réflexions, dont ta fin manque au manuscrit, était sans doute d'établir l'excellence du Consulat, et de le considérer comme l'élément le mieux choisi d'un gouvernement mixte. Mais combien Cicéron n'éprouva-t-il pas lui-même, après avoir si glorieusement usé de cette dignité, la faiblesse d'une magistrature passagère, sans cesse usurpée par l'intrigue, vendue par la corruption, envahie par la force, et enfin anéantie par cette terrible dictature, la dernière punition des États où les lois n'ont pas assez conservé de puissance. [21] « Le portrait de Tarquin n'a point été flatté; son nom n'a échappé à aucun des orateurs qui ont eu à parler contre la tyrannie; mais sa conduite, avant son malheur, que l'on voit qu'il prévoyait, sa douceur pour les peuples vaincus, sa libéralité envers les soldats, cet art qu'il eut d'intéresser tant de « gens à sa conservation, ses ouvrages publics, son courage à la guerre, sa constance dans son malheur, une guerre de vingt ans qu'il fit ou qu'il fit faire au peuple romain, sans royaume et sans biens, ses continuelles ressources, font bien voir que ce n'était pas un homme ordinaire. Les places que la postérité donne sont sujettes, comme les autres, aux caprices de la fortune. Malheur à la réputation de « tout prince qui est opprimé par un parti qui devient le dominant, ou qui a tenté de détruire un préjugé qui lui survit! » (Grandeur et décadence des Romains.) Cette hypothèse ingénieuse, et brillamment exprimée, est tout à fait démentie par .le passage de Cicéron. Appréciateur impartial de la royauté, il semble ici, comme il l'a fait d'ailleurs dans le traité des Lois, imputer aux crimes réels de Tarquin, et non à la nature de l'ancien gouvernement de Rome, la haine des Romains pour la monarchie. La même idée se retrouve plus d'une fois dans Tite-Live; mais elle est plus remarquable dans Cicéron, qui n'écrivait pas sous l'empire des Césars, et qui serait mort pour le combattre. [22] Cicéron disait au peuple romain, dans son beau discours contre la loi agraire : « Je conserve chèrement la mémoire des Grecques, de ces deux illustres frères qui sacrifièrent leur vie pour faire restituer au peuple les terres que des particuliers avaient envahies. » Mais il fait parler ici le grand Scipion, l'adversaire des Gracques; et d'ailleurs lui-même, par le plan de son ouvrage, sans excuser l'odieux assassinat de Tibérius et de Caïus, devait réprouver en eux le génie des premiers novateurs qui portèrent atteinte à la vieille Constitution romaine. Il est bien à regretter qu'une lacune interrompe ce passage. [23] Plusieurs pages manquent ici, et nous font perdre ce portrait du sage et vertueux souverain, que Cicéron avait sans doute tracé avec des couleurs dignes du pinceau de Fénelon. [24] Montesquieu, dans le livre XI de l’Esprit des Lois, fait un beau chapitre sur l'état de Rome après l'expulsion des rois; et quelques-unes de ses réflexions rentrent dans ce que Cicéron exprime ici : « La situation des choses, dit Montesquieu, demandait que Rome fût une démocratie ; et cependant elle ne l’était pas : il fallut tempérer le pouvoir des principaux, et que les grands inclinassent vers la démocratie. » [25] « A Athènes et à Rome, il fut d'abord permis de vendre les débiteurs qui n'étaient pas en état de payer. Solon corrigea cet usage, à Athènes : il ordonna que personne ne serait obligé par corps pour dettes civiles, etc. Ces lois cruelles contre les débiteurs mirent bien des fois en danger la République romaine. Un homme couvert de plaies s'échappa de la maison de « son créancier, et parut dans la place. Le peuple s'émut à ce « spectacle. D'autres citoyens, que leurs créanciers n'osaient plus retenir, sortirent de leurs cachots. On leur fit de» promesses; on y manqua : le peuple se retira sur le mont Sacré. Il n'obtint pas l'abrogation de ces lois ; mais un magistrat pour le défendre. On sortait de l'anarchie ; on pensa tomber dans la tyrannie. » {Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XI.) [26] « Le spectacle de la mort de Virginie, immolée par son père à la Pudeur et à la Liberté, fit évanouir la puissance des décemvirs. Chacun se trouva libre, parce que chacun fut offensé. Tout le monde devint citoyen, parce que tout le monde se trouva père. Le sénat et le peuple rentrèrent dans une liberté qui avait été confiée à des tyrans ridicules. Le peuple romain, plus qu'aucun autre, s'émouvait par des spectacles. Celui du corps sanglant de Lucrèce fit finir la royauté. Le débiteur qui parut sur la place, couvert de plaies, fit changer la forme de la République. La vue de Virginie fit chasser les décemvirs. Pour condamner Manlius, il fallut ôter au peuple la vue du Capitule. La robe sanglante de César remit Rome dans la servitude. » (Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XI.) [27] Ici commence une longue lacune. M. Mai, dans sa note latine, fait une description, pour ainsi dire pathologique, de l'état du manuscrit en cet endroit. Il énumère les cahiers et les pages perdues ; il additionne ces désastres littéraires ; il conjecture, par des calculs arithmétiques, dans quelle proportion se trouve mutilé ce second livre, et quelle était son étendue primitive. Respectable sollicitude, qui, indépendamment de tant d'autres preuves incontestables, attesterait, s'il était besoin, la probité littéraire, que M. Mai a portée dans cette importante publication! Au reste, en adoptant les soigneuses et tristes évaluations de l'éditeur sur le vide que présente ici le manuscrit, nous n'essayerons nullement d'y suppléer. On voit seulement que Scipion, après être entré sans doute dans des réflexions générales et métaphysiques sur l'origine et la nature du pouvoir, et après en avoir cherché le modèle dans l'ordonnance même de l'univers, était conduit à dessiner le portrait particulier du politique, ou de l'homme d'État, sujet que Cicéron traite avec une orgueilleuse complaisance, et auquel il revenait encore dans le sixième livre de ces mêmes dialogues. [28] Ici nouvelle interruption, dont l'éditeur n'essaye pas de mesurer l'étendue. Il se console un peu, en recueillant quelques phrases éparses dans les grammairiens, et qui appartenaient sans doute à cette portion perdue du deuxième livre. Dans l'une de ces phrases, Cicéron compare l'homme d'État imprudent à l'écuyer malhabile qui, renversé du char, est froissé, meurtri, déchiré. Dans une autre phrase, traduite par Lactance, cette même comparaison reçoit un développement plus étendu. « Les passions, disait Cicéron, ressemblent à un char attelé. Pour le bien diriger, le premier devoir du conducteur est de connaître le chemin : s'il le suit une fois, quelle que soit la rapidité de sa course, il ne heurtera pas; mais s'il est égaré, marchât-il avec lenteur et précaution, il se débattra sur des terrains impraticables, il s'abîmera dans les précipices, ou du moins il se détournera vers des lieux, où il n'a que faire. » Les autres fragments de citations rapportés au bas du texte ne sont, pour ainsi dire, que des exemples de locutions latines, et n'offrent aucun sens complet et satisfaisant. L'ensemble de ces faibles débris peut indiquer seulement que Scipion discutait sur les devoirs, les passions, les vertus de l'homme d'État. [29] Cette belle comparaison nous avait déjà été conservée par saint Augustin; et Montesquieu l'a même imitée. « Ce que l'on appelle union, dans un corps politique, dit-il, est une chose fort équivoque. La vraie est une union d'harmonie qui fait que toutes les parties, quelque opposées qu'elles nous paraissent, concourent au bien général, comme des dissonances, dans la musique, qui concourent à l'accord total. » (Grandeur et décadence des Romains, chap. X.) [30] Saint Augustin nous apprend à peu près, quoique d'une manière infiniment abrégée, ce que pouvait renfermer le passage qui manque ici. « Lorsque, dit-il, Scipion eut exposé, avec beaucoup d'abondance et d'étendue, combien la justice était profitable aux États, et l'absence de ce principe leur était funeste. Philus, un des auditeurs, prit la parole, et demanda que ce « point fût discuté plus exactement, et que l'on ajoutât de nouvelles raisons en faveur de la justice, à cause de l'opinion fort répandue, qui consiste à croire que l'on ne peut gouverner sans le secours de l'injustice. » Cette assertion était probablement combattue ; et Scipion, comme nous le voyons dans notre texte mutilé, reprenait la parole, pour appuyer le démenti d'une maxime si funeste, en attendant qu'elle fût détruite par une discussion approfondie, que l'on réserve pour l'entretien suivant. |